Géographie et système politique : quelles relations ? Le Canada est le deuxième plus vaste pays du monde, après la Russie et tout juste avant la Chine. Pour faire image, on peut rappeler que le territoire du Canada est dix-sept fois plus étendu que celui de la France. On peut comprendre que la géographie du Canada impose à ce pays autre chose qu’un régime unitaire comme en ont quelque 180 pays.
Le Canada est une fédération, dont les États fédérés, appelés provinces, bénéficient, en toute autonomie, chacun sur son territoire, d’une souveraineté qui s’étend à de nombreux domaines (le grand nord, peu habité, a une organisation particulière). Les institutions politiques, celles de l’État fédéral et celles des États fédérés, sont celles d’une monarchie constitutionnelle et suivent les principes du parlementarisme de type britannique, appliquant les règles d’une démocratie de représentation fondée sur l’élection (au suffrage universel) des dirigeants, pour des mandats de cinq ans, non cumulatifs, selon le mode de scrutin uninominal à un tour. Au Canada, une charte des droits et libertés vise à garantir l’expression de la diversité des opinions, traduite, notamment, dans la compétition entre les partis politiques et dans la concurrence entre d’innombrables groupes d’intérêts.
Dans le cadre de ses synergies géopolitiques, le diploweb.com est heureux de vous présenter sur Internet un chapitre extrait de La société canadienne en débats. What holds Canada together ? ..., dirigé par Alain Faure et Robert Griffiths, publié chez L’Harmattan, 2008, 221 p.
PARMI les particularités du système politique canadien, il en est quatre qui contrastent vraiment par rapport à celles de la France : alors que 90 % des pays du monde sont des Etats unitaires, le Canada est une fédération, ce que la France n’est pas ; il est l’un des très rares pays du monde qui ont eu recours sans interruption, depuis plus d’un siècle, à des élections libres, pluralistes et fréquentes pour le choix de leurs principaux dirigeants, cependant, malgré sa longue tradition démocratique, il a, comme le Royaume-Uni et contrairement à la France, conservé un cadre monarchique ; par ailleurs, à la différence des pays du Nouveau Monde qui ont des régimes présidentiels, le Canada a gardé son parlementarisme de type britannique, et pour cette raison également il paraît différent de la France ; le Canada, enfin, se distingue de la France par la façon dont ses partis politiques sont divisés.
Nous allons examiner chacun de ces quatre points.
Découvrez comment les Canadiens vivent en hiver par grand froid. Un photo-reportage Diploweb.
Le féréralisme canadien
Formé de dix États fédérés (appelés « provinces »), au sud de son territoire arctique, le Canada est l’un des quatre pays du monde qui ont conservé depuis plus de cent ans, sans interruption, une structure fédérale (les autres sont les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse et l’Australie). Comme les autres vraies fédérations, le Canada est doté d’une constitution qui attribue au corps législatif de chacun de ses États fédérés le pouvoir exclusif d’adopter et d’appliquer, sur son territoire, des lois relatives à un grand nombre de sujets.
Parmi les sujets que la Constitution attribue en exclusivité aux corps législatifs « provinciaux » figurent l’éducation, les ressources naturelles et les terres publiques, l’administration de la justice et les prisons, les hôpitaux (ce qui implique, en pratique, l’ensemble des soins de santé), les institutions municipales, les travaux que l’on dit publics (cas, par exemple, des routes), la propriété et les droits civils, et, plus généralement, les matières d’une nature locale ou privée.
Aujourd’hui, au Canada, les budgets consacrés à l’application des lois provinciales sont plus considérables que ceux qui concernent les dépenses dites « finales » du gouvernement fédéral. Ces budgets ont gonflé en raison de l’augmentation des prestations de solidarité versées aux personnes (aide sociale, etc.), de la croissance des fonds publics accordés à l’éducation et aux services de santé, et de la demande grandissante pour des services publics urbains de plus en plus coûteux.
Même si les articles de la Constitution décrivant les institutions et leurs pouvoirs ne peuvent être modifiés sans le consentement des autorités concernées, ce qu’on appelle « l’autonomie provinciale » serait illusoire si le contenu des lois provinciales était dicté par les décideurs d’Ottawa, la capitale fédérale, ou par un éventuel parti politique unique comme celui qui régnait sur la défunte Union soviétique. Cette autonomie, au Canada, est devenue bien réelle, quoique toujours menacée par ceux qui tentent de la réduire.
Pour financer leurs dépenses avec leurs propres revenus fiscaux, les autorités provinciales ont, grâce à la Constitution, accès à diverses sources de revenu et, en particulier, aux « impôts directs » (lesquels englobent tous les prélèvements obligatoires, hormis les droits de douanes et quelques autres charges indiscutablement supportées par d’autres personnes que celles qui les acquittent). Le Parlement du Canada, de son côté, peut percevoir des revenus par tout mode de taxation.
L’addition d’impôts provinciaux aux impôts fédéraux (ou inversement) a déjà créé des perturbations considérables ; pour mettre fin à de telles perturbations ou pour les éviter, il faut des ententes entre les autorités, fédérales et provinciales.
Insistons, ici, sur un point qui échappe à la perception de nombreuses personnes : dans une fédération authentique, l’État fédéral n’impose pas ses décisions aux États fédérés, qui ne lui sont pas subordonnés ; c’est pourquoi, dans le respect des principes du fédéralisme, on dit des États fédérés qu’ils forment un « ordre de gouvernement » (plutôt qu’un « niveau », ce mot impliquant une hiérarchie, comme il y en a dans les régimes unitaires).
Au cours de l’histoire de la fédération canadienne, les élus d’Ottawa ont tenté, à maintes reprises, d’imposer leur volonté en dépit des principes du fédéralisme, mais aujourd’hui, ils le font rarement, de sorte que le Canada apparaît comme une authentique fédération.
Le fédéralisme canadien d’aujourd’hui apparaît ainsi fort différent de ce qu’on appelle la « décentralisation territoriale » observée dans certains pays unitaires, dont la France. En France, ce sont les autorités de la République qui décident des compétences attribuées aux régions, aux départements et aux communes ; au Canada, c’est la Constitution qui fixe le champ des compétences des États fédérés, les provinces, et, dans la pratique, les autorités de chacune des provinces décident « en pleine souveraineté » des lois relevant des compétences provinciales.
Ceci dit, de nombreuses personnes, même parmi celles qui vivent au Canada, ont du mal à saisir les particularités d’une vraie fédération. Ayant à l’esprit le modèle des pays unitaires, ces personnes pensent que l’État fédéral canadien possède tous les pouvoirs d’un Etat « normal » et qu’il a simplement délégué certaines de ses attributions aux autorités provinciales. On rencontre parfois des Canadiens qui, ignorant tout du fédéralisme authentique, se croient « fédéralistes » parce qu’ils veulent que l’État fédéral devienne l’unique centre du pouvoir, souhaitant même l’abolition des institutions provinciales...
L’idée de copier, au Canada, le modèle des pays unitaires a été et est encore source d’affrontements et elle peut même expliquer, en partie, le projet de séparer le Québec du reste du pays (à une diminution de l’autonomie provinciale, de nombreux Québécois préfèreraient les risques inhérents à une sécession). Pour le moment, devant des décisions, prises à Ottawa, qui empiètent sur les compétences législatives des provinces ou menacent l’autonomie provinciale, les « autonomistes » s’insurgent et, généralement, arrivent à faire prévaloir les principes du fédéralisme.
Au Canada, depuis quelques décennies, au grand dam des personnes qui veulent plus de « centralisation », c’est en effet le respect des principes du fédéralisme qui s’impose, car on a généralement compris, au sein de l’élite canadienne, que l’application d’un fédéralisme authentique était la seule façon d’éviter la sécession du Québec et, après elle, celle d’autres régions. Le respect des principes du fédéralisme authentique est une des façons de sauvegarder l’unité du Canada.
En 1982, marquant cette option en faveur d’un fédéralisme authentique, une importante addition à la Constitution de 1867 est entrée en vigueur. Cette addition lui a ajouté une Charte des droits et libertés, présentée comme un modèle du genre, elle a précisé les façons d’opérer pour y effectuer de futures modifications et elle a énoncé divers principes, notamment celui qui concerne la « péréquation ».
Ce mot, « péréquation », désigne, au Canada, l’attribution, par les autorités fédérales, de sommes d’argent aux autorités des provinces les moins prospères du pays ; ces paiements sont financés par les impôts, taxes, droits et autres prélèvements obligatoires perçus en vertu de lois fédérales. Les revenus tirés de ces paiements sont utilisés de façon pleinement autonome par les autorités provinciales.
La péréquation canadienne vise à donner aux autorités de chacune des
provinces les ressources financières requises pour faire bénéficier les citoyens de cette province de services publics provinciaux analogues à ceux dont bénéficie la moyenne, dans l’ensemble du pays.
Le montant des paiements de péréquation varie, d’année en année, selon que croissent ou diminuent les écarts entre les provinces, du point de vue du revenu par habitant. Si, un jour, ces écarts disparaissaient, il n’y aurait plus de paiement de péréquation !
Le droit de dépenser de façon autonome les sommes reçues s’applique aujourd’hui à la quasi-totalité des paiements que les autorités fédérales versent aux autorités provinciales.
En raison de tous ces paiements, péréquation comprise, le montant des dépenses qui relèvent de l’ensemble des autorités provinciales du Canada dépasse d’environ 20% le montant de leurs revenus propres, ces revenus propres étant tirés, eux, des impôts, taxes, droits et autres prélèvements obligatoires perçus en vertu de lois provinciales. La proportion des paiements reçus d’Ottawa dans le budget d’une province est d’autant plus faible que cette province est plus riche, du point de vue du revenu par habitant.
Pour respecter les principes du fédéralisme, on a recours, au Canada, à des négociations encadrées par un système complexe de « relations intergouvernementales » (dites « fédérales-provinciales » à l’époque où elles n’impliquaient pas de représentants des territoires du Nord). Les négociations engagées dans ce cadre ont permis des compromis comme ceux qui concernent la péréquation ou ceux qui ont accentué le caractère distinct du Québec, dont la population, à 85% francophone, regroupe 80% des francophones du Canada. La preuve : le Québec a une Régie des rentes et une Caisse des dépôts, uniques au Canada, et une quantité de politiques qui lui sont propres.
La monarchie constitutionnelle canadienne et la démocratie au Canada
La constitution qui a créé le Canada, en 1867, a consacré le caractère monarchique des institutions des colonies qu’elle regroupait. La colonie de la Nouvelle-Ecosse et celle du Nouveau-Brunswick sont devenues deux provinces de ce qu’on a alors appelé le « Dominion du Canada », les deux autres, le Québec et l’Ontario, étant issues de la division de la colonie qui s’appelait jusqu’alors, et depuis 1840, le Canada-Uni. Aux quatre provinces de 1867 se sont ajoutées, par la suite, celles du Manitoba (1870), de la Colombie-Britannique (1871), de l’Ile du-
Prince-Édouard (1873), de la Saskatchewan et de l’Alberta (1905), puis celle de Terre-Neuve (1949). Avant de devenir provinces, les territoires concernés étaient dotés d’institutions semblables à celles du Royaume-Uni, une monarchie. En devenant des provinces, ils ont conservé leurs institutions, le représentant du monarque dans chaque province étant dorénavant appelé lieutenant gouverneur plutôt que gouverneur.
La personne à qui est confiée la charge de lieutenant-gouverneur est nommée par le représentant du monarque au Canada, appelé, lui, gouverneur général, ce dernier étant nommé par la personne portant la couronne (la reine Victoria jusqu’en 1901, ses descendants par la suite, en particulier Élisabeth II depuis 1952). Le gouverneur général réside à Ottawa et chaque lieutenant gouverneur réside dans la capitale de la province où il représente la Couronne.
Les personnes qui ne connaissent pas bien le Canada ne peuvent pas s’expliquer comment ce pays conserve comme chef d’État un monarque qui n’y réside pas.
Une explication, on l’a compris, se trouve dans le fait que la constitution qui a créé la fédération canadienne date de l’époque où les territoires de l’Amérique du Nord britannique étaient encore des colonies de la Couronne britannique et dans le fait qu’elle ne peut pas être modifiée ou abrogée facilement (la preuve en est qu’elle date de 1867, ce qui contraste avec la durée moyenne d’une constitution française).
Les dispositions de cette constitution qui concernent la monarchie ne peuvent pas être modifiées sans l’accord du Parlement du Canada (le parlement fédéral) et l’accord de l’assemblée de chacune des provinces du Canada.
Comme la monarchie n’indispose pas grand monde et comme on ne saurait se mettre d’accord sur une solution de remplacement (d’autant qu’il faut l’unanimité des parties), la personne qui hérite de la couronne du Royaume-Uni hérite, en vertu des lois canadiennes, de la couronne du Canada.
Le Canada est une démocratie même si le chef d’État du Canada est un monarque, représenté au Canada par une personne qui n’est pas élue (dans les faits, la reine Elisabeth II a toujours nommé au poste de gouverneur général la personne que lui suggérait le Premier ministre du Canada). Parmi les dix personnes qui ont représenté la reine, depuis 1952, il y a eu trois femmes, dont deux sont nées à l’étranger ; neuf de ces dix personnes étaient capables de s’exprimer facilement en français et en anglais, les deux langues officielles du Canada.
Le Canada est une démocratie parce que le pouvoir de faire les lois et de les mettre en œuvre appartient à des personnes élues par la population, pour des mandats qui, conformément à la Constitution, ne dépassent pas cinq ans.
Néanmoins, même s’il ne participe plus à l’élaboration des décisions politiques qu’il entérine, le représentant (ou la représentante) de la reine détient toujours une autorité formelle dont il convient de rendre compte. Là où il réside (à Ottawa ou dans une capitale provinciale), le gouverneur doit assurer la continuité de l’État et le respect du droit, ce qui implique, notamment, l’émission de « brefs d’élections » et la nomination, dans le respect des conventions, des membres de l’exécutif.
Le choix des personnes chargées d’exercer le pouvoir exécutif est dicté par des conventions auxquelles on ne déroge pas : à l’issue d’élections qui auraient renversé la majorité précédente, ce choix doit porter, d’abord, sur le chef de parti qui a dorénavant l’appui d’une majorité parmi les députés, et ensuite sur les personnes que ce chef de parti désigne. Ce chef de parti prend alors le titre de Premier ministre et les autres membres de l’exécutif (appelé communément « conseil des ministres » ou « cabinet ») acquièrent « l’honneur » de se faire appeler ministres et « honorables ».
S’il perd l’appui de la majorité des députés (à Ottawa ou dans une capitale provinciale, selon le cas), un Premier ministre a deux options : la première, offerte dans certaines circonstances, consiste à s’en remettre au peuple, avec de nouvelles élections ; la deuxième, c’est sa démission, qui entraîne celle de ses ministres et qui amène le gouverneur à nommer, pour le remplacer, le chef de parti qui commande dorénavant l’appui de la majorité des élus.
Au Canada, on n’a pas adopté la pratique des gouvernements de coalition, à laquelle beaucoup d’Européens sont habitués. Quand aucun parti n’a la majorité absolue des sièges dans l’assemblée élue, le gouvernement est confié au chef du parti qui peut avoir l’appui de quelques parlementaires d’autres partis pour faire adopter ses projets de loi (cela vaut pour la Chambre des communes à Ottawa comme pour chacune des assemblées provinciales). Aucun membre de ces autres partis n’est invité à participer au gouvernement. Il n’y a pas de coalition (alors qu’il y en a souvent en France).
Ce refus des coalitions n’a pas eu de réelles exceptions depuis que les partis d’aujourd’hui existent. Il y a eu, certes, dans l’histoire lointaine de quelques provinces, des épisodes (un seul par province et, chaque fois, pour une courte durée) qui ont permis de parler de coalitions, mais les partenaires de ces coalitions étaient déjà unis lors des élections précédentes de sorte que leurs gouvernements n’étaient pas de vraies coalitions. Il y a eu, aussi, à Ottawa, une entente entre parlementaires libéraux et conservateurs pour former ce qu’on a appelé un gouvernement d’Union (avec des candidats « unionistes » aux élections de 1917), mais, ayant une nette majorité, les conservateurs n’ont conçu cette apparente coalition que pour soutenir l’effort de guerre.
En refusant de former une coalition avec un petit parti alors que son propre parti n’a pas la majorité, un Premier ministre évite de se retrouver avec des ministres qu’il n’a pas choisis ou, pire, avec des adversaires, et il évite ainsi de renforcer un autre parti que le sien.
Autre particularité par rapport à ce qui se voit en France : au Canada, les ministres doivent être des parlementaires (une personne qui devient ministre sans être déjà parlementaire doit, sans délai, se faire élire dans une circonscription, faute de quoi sa démission s’impose). Il s’ensuit que les personnes qui exercent le pouvoir exécutif ont, en général, ce qu’on appelle le « flair électoral » ou la « sensibilité démocratique », car elles ont fréquenté des électeurs de divers milieux, ce qui n’est pas le cas de ministres qui n’ont jamais eu à se faire élire. On considère comme un trait démocratique le fait que les ministres, au Canada, sont des élus (cependant, à Ottawa, il y a généralement, parmi les ministres, un membre du Sénat, ancien député).
En plus de nommer les ministres et d’émettre les brefs d’élections, le gouverneur doit poser, sur la recommandation du Premier ministre, divers autres gestes prévus par la Constitution. Il doit signer la convocation des parlementaires pour ce qu’on appelle une « session », ou l’avis de « prorogation » d’une session et l’ordre de « dissolution » en vue de nouvelles élections (celle de la Chambre des communes d’Ottawa ou de l’assemblée de la province, assemblée que l’on dit « nationale » au Québec). Le gouverneur doit aussi procéder à diverses nominations (par exemple, à Ottawa, celles des membres du Sénat canadien et des juges de certains tribunaux).
La Constitution précise, incidemment, que les parlementaires ne peuvent pas affecter de fonds publics en l’absence d’une recommandation du gouverneur. Cette disposition rend impossible l’adoption d’une mesure financière autre que celles que présente le pouvoir exécutif.
Le gouverneur général à Ottawa ou le lieutenant-gouverneur dans une province (s’il n’a pas de délégataire) est aussi appelé à contresigner les projets adoptés par les parlementaires, projets qui, portant enfin sa signature, deviennent lois. On appelle « sanction royale » (royal assent) le geste ainsi posé, lequel, on l’a compris, est dicté par le Premier ministre ou un porte-parole du Premier ministre.
Le gouverneur général, à Ottawa, ou le lieutenant-gouverneur, dans une province, fait la lecture du texte qui inaugure chacune des sessions parlementaires. Ce texte, appelé « discours du Trône » (ou discours inaugural), est préparé par les services du Premier ministre de l’endroit.
Insistons sur ce point : les actes posés par un gouverneur, conformément à la Constitution, sont dictés par le Premier ministre ou son porte-parole, à moins d’une improbable crise parlementaire, crise dont on n’a pas eu d’exemple, au Canada, sauf en Colombie-Britannique, entre 1898 et 1903, alors qu’aucun prétendant au poste de Premier ministre n’arrivait à constituer une majorité, et à
Ottawa, en 1926.
On ne peut pas dire que le représentant du monarque, à Ottawa ou dans une capitale provinciale, bénéficie d’une sinécure, car il remplit des tâches nombreuses, certaines n’étant même pas prévues par les lois, comme l’accueil des membres de la famille royale lors de leur visite au Canada ou d’hôtes étrangers que les autorités veulent honorer.
Il faut ajouter que, dans la capitale où il réside, le représentant de la Couronne est appelé à rehausser de sa présence de très nombreuses manifestations (bals, banquets, défilés, inaugurations, distribution de titres, décorations ou médailles, commémorations, etc.).
En définitive, au Canada, c’est le représentant de la Couronne qui assume une bonne part des heures qu’un chef d’Ëtat dans un régime présidentiel doit consacrer aux cérémonies et aux « formalités », des heures qu’il n’a pas pour l’étude des dossiers qui lui sont soumis. Parce qu’il n’a pas à s’occuper des formalités qui relèvent du gouverneur, un Premier ministre, au Canada, a, forcément, plus de temps pour l’étude de ses dossiers que n’en a le chef d’État dans un régime présidentiel.
Il faut ajouter que, contrairement à ce qui se passe dans un pays unitaire, le fédéralisme canadien libère le Premier ministre du Canada d’une quantité de dossiers difficiles qui, eux, relèvent des Premiers ministres des provinces, lesquels, de leur côté, n’ont pas à s’occuper de tout ce qui intéresse l’électorat.
Le parlementarisme canadien
La prééminence du Premier ministre dans la vie politique, tant à Ottawa que dans chacune des capitales provinciales, est une importante caractéristique du parlementarisme canadien. Cet ascendant lui vient d’abord du fait qu’il est le chef, le vrai chef, du parti qui lui a permis d’accéder à la tête du gouvernement. Puisqu’il a été préféré à ses concurrents lors des élections, il bénéficie d’une popularité personnelle qui lui assure la fidélité de ses ministres, qu’il choisit lui même et qu’il peut, au besoin, exclure de son gouvernement sans autre forme de procès. La situation d’un Premier ministre au Canada, à Ottawa ou dans une capitale provinciale, contraste avec celle de Premiers ministres qui, dans d’autres pays, n’ont pas tous ses atouts, n’ayant même pas, parfois, pu choisir eux-mêmes les ministres qui les entourent. Le contraste avec la France est, à cet égard, impressionnant.
En plus de présenter les particularités qui viennent d’être citées, le parlementarisme canadien a conservé plusieurs de ses traits d’origine, ceux de l’époque où le Canada était un territoire neuf, peu peuplé.
Ainsi, une assemblée provinciale typique ne réunit qu’une soixantaine de membres ; avec ses 125 membres, l’Assemblée nationale du Québec est, de loin, la plus considérable des assemblées provinciales. Alors que la population de chaque province a crû considérablement, le nombre de membres dans les assemblées provinciales n’a presque pas augmenté. Le nombre de membres de la Chambre des communes d’Ottawa, depuis 1867, n’a même pas doublé alors que la population du Canada a décuplé. En 139 ans, le nombre de membres du Sénat (à Ottawa) est passé de 72 à 105. En définitive, par le petit nombre de ses parlementaires, compte tenu de sa population, le Canada présente une autre particularité, par rapport à la France.
Par ailleurs, les parlementaires, au Canada, font montre d’une assiduité qui paraitrait exemplaire aux Européens (notamment aux Français), si ces derniers avaient l’occasion de l’observer ! Cette assiduité vient en partie du fait qu’un parlementaire, au Canada, ne peut pas déléguer son droit de vote à un collègue et du fait qu’une absence se voit facilement dans un petit groupe. Cependant, exemplaire quand on la compare, cette assiduité ne semble pas satisfaire certains électeurs canadiens qui pensent que leurs élus n’ont rien à faire !
Autre différence : les parlementaires, au Canada, ne pratiquent pas, comme en France, le cumul des mandats. L’interdiction d’être élu à la fois à la Chambre des communes d’Ottawa et à l’assemblée d’une province date de 1874. L’élection d’un maire à une assemblée provinciale ou à la Chambre des communes d’Ottawa entraine sa démission du conseil municipal. Aucun cumul n’a été recensé depuis très longtemps. C’est clair, c’est net, et cela donne des parlementaires qui, dans l’ensemble, sont à leur affaire... Du point de vue des électeurs canadiens insatisfaits des décisions, cela, certes, ne suffit pas, mais, du point de vue d’une comparaison avec la France, cela fait contraste.
De plus, les parlementaires, au Canada, sont particulièrement ouverts à ce qu’on appelle la participation des citoyens. La division du travail entre les institutions fédérales et les institutions provinciales favorise cette participation. La pratique des commissions parlementaires ouvertes aux citoyens est devenue générale au Canada, et les consultations publiques organisées à propos de questions controversées y sont très fréquentes, beaucoup plus fréquentes, en tout cas, que dans bien d’autres pays, y compris en France. Il est très facile, au Canada, de former des organisations pour tenter d’influencer les décisions politiques (le lobbying qui se fait au Canada étonnerait, en France). On observe d’ailleurs, au Canada, depuis quelques décennies, une prolifération d’organisations de ce type, en raison, certes, de la complexification de l’économie comme en raison de l’hétérogénéité croissante de la société (notamment quant aux langues parlées par les gens et aux religions auxquelles ils adhèrent), mais aussi, il faut le répéter, en raison de l’attitude des parlementaires, tant ceux d’Ottawa que des capitales provinciales, les uns et les autres étant, en quelque sorte, en concurrence dans la recherche de soutiens.
Les organisations qui tentent d’influencer les décisions politiques, au Canada, sont d’autant plus nombreuses qu’elles sont spécialisées en fonction des intérêts ou des opinions, et spécialisées également selon diverses portions du territoire (localité par localité, région par région, province par province) ou diverses catégories de personnes, et, enfin, divisées de façon à refléter le partage des compétences législatives et réglementaires (entre autorités fédérales et autorités provinciales, puis, dans chaque province, entre les autorités provinciales et les institutions décentralisées que sont les municipalités et diverses autres instances sectorielles ou régionales).
Cette participation de si nombreuses organisations à la vie politique, au Canada, est pourtant perçue, par de nombreux Canadiens, comme insuffisante ou biaisée, d’autant qu’elle ne permet pas de satisfaire tout le monde puisque les détenteurs des postes d’autorité ont à choisir entre des options concurrentes ou, même, contradictoires. Néanmoins, s’ils comparaient leurs perceptions de la vie politique canadienne aux observations que l’on peut faire de la vie politique de certains autres pays, dont la France, ces Canadiens se consoleraient probablement !
D’un autre côté, les insatisfactions ressenties par les perdants, dans les jeux d’influence, expliquent sans doute, en partie, l’augmentation de l’abstentionnisme électoral, que l’on peut regretter, au Canada comme dans de nombreux autres pays, encore que, lors du référendum tenu au Québec en 1995, 95% des électeurs ont voté (taux inégalé dans un référendum tenu en France).
Autre particularité : le monocamérisme des institutions législatives des provinces, qui contraste avec le bicamérisme que la France a conservé. Les institutions législatives provinciales ne comportent qu’une seule chambre (d’où le mot « monocamérisme »). Le contraste frappe d’autant plus que 49 des 50 États des États-Unis d’Amérique ont deux chambres, dont un Sénat.
Un Sénat, il y en a un à Ottawa, cependant. Ce Sénat est formé de personnes choisies par le Premier ministre en fonction à Ottawa au moment de leur nomination. Choisis par un Premier ministre d’Ottawa et nommés par un gouverneur général d’Ottawa, les membres du Sénat canadien ne représentent assurément pas les autorités provinciales ni les électorats des provinces. Pour cette raison, ce Sénat se distingue du Sénat français aussi bien que du Sénat des États-Unis d’Amérique (deux sénateurs pour chacun des 50 États de la fédération, élus par les citoyens de cet État) et du Bundesrat d’Allemagne (dont les membres sont désignés, Land par Land, par le gouvernement du Land concerné).
En poste jusqu’à leur soixante-quinzième anniversaire et inamovibles jusqu’à leur retraite (autre distinction dans une comparaison avec la France), les sénateurs canadiens se considèrent, en général, comme des législateurs chargés de veiller à ce que les projets de loi adoptés préalablement par la Chambre des communes ne comportent pas d’éléments que la majorité, à la Chambre des communes, regretterait, si on les soumettait à nouveau à la réflexion.
Il s’ensuit que de tels éléments, quand il s’en trouve, font l’objet d’un amendement du Sénat, transmis à la Chambre des communes, pour approbation, approbation qui arrive presque toujours. Quand elle n’arrive pas, le Sénat, le plus souvent, n’insiste pas et adopte le texte voulu par la majorité de la Chambre des communes.
La majorité, au Sénat, peut ne pas être celle du gouvernement, quand les élections à la Chambre des communes ont entraîné une alternance au pouvoir. Cela s’est produit à l’issue des élections du 23 janvier 2006, mais cela n’entraîne aucune conséquence majeure, puisque le Sénat ne peut forcer un gouvernement à démissionner, même s’il n’adopte pas tous les projets de loi de ce gouvernement (dans le passé, les très rares obstructions menées par une majorité d’opposition, au Sénat, n’ont porté que sur des sujets extrêmement controversés).
Dans le passé, quand la majorité au Sénat canadien n’était pas celle de la Chambre des communes (en 1984 et peu après, notamment), de nombreux projets de réforme du Sénat ont fleuri. Des gens ont alors proposé l’abolition du Sénat, alors que d’autres voulaient le transformer suivant le modèle du Sénat des États-Unis d’Amérique ou du Bundesrat d’Allemagne. On peut s’attendre à une nouvelle floraison de tels projets.
Aucun de ces projets ne pourra cependant être adopté sans le consentement d’une majorité des membres du Sénat tel qu’il existe présentement (24 sièges du Sénat sont réservés à des résidants du Québec, 24 à des résidants de l’Ontario, 24 à des résidants de l’Ouest et 33 à des résidants d’ailleurs, dans le pays). Un tel projet devrait aussi avoir l’aval de la Chambre des communes d’Ottawa (qui compte présentement 308 sièges répartis en fonction de la population) et des assemblées d’au moins sept provinces, avec 50% de la population du Canada. On peut conclure que le Sénat canadien restera longtemps ce qu’il est, tout comme persiste, depuis plus d’un siècle, le même parlementarisme.
Ce parlementarisme a même été adopté dans les trois territoires autonomes du Nord (Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon) dont les assemblées, de création récente, ne comptent que 18 ou 19 personnes. Ces territoires, très vastes et peu peuplés (26 000 habitants au Nunavut, par exemple), ne sont pas des provinces, et ils dépendent, pour leur financement et bien autres choses encore, de décisions prises à Ottawa.
Alors qu’il s’impose dans les institutions législatives, fédérales et provinciales, le parlementarisme n’est pas en vogue dans les quelque 5 000 municipalités du Canada (qui relèvent des autorités provinciales ou territoriales), parce que le conseil municipal typique n’a que sept membres, y compris le maire (ou la mairesse, titre que prend, au Canada, une femme qui accède à la tête d’une municipalité). Seules les grandes villes sont dotées de conseils municipaux comptant plus d’une dizaine de membres. À noter toutefois : les délibérations publiques des conseils municipaux respectent une procédure typiquement parlementaire.
On aura déjà vu le contraste : pour une population qui n’est pas le double de celle du Canada, la France compte six fois plus de municipalités, et une petite ville de France a quatre fois plus d’élus municipaux qu’une ville canadienne de même population. Les lois relatives aux municipalités, dont le contenu varie selon les provinces et les territoires, valorisent la participation au processus d’élaboration des décisions, mais cette participation se fait normalement sans affrontements partisans comme on en voit en France. Au Canada, d’ailleurs, lors des élections municipales, il arrive souvent que chaque poste à combler n’attire qu’un seul candidat, qu’on dit alors « élu par acclamation ».
Les partis politiques au Canada
Au Canada, les partis politiques qui ont des membres au Parlement d’Ottawa sont appelés « partis fédéraux » et ils sont distincts des partis politiques qui ont des membres au sein des institutions législatives des provinces et des territoires, lesquels sont distincts des « partis municipaux » qui peuvent être installés dans certaines villes (au Québec, pour citer ce cas, il y avait, en 2005, répartis dans 4% des municipalités, 137 partis municipaux dûment inscrits au registre tenu par le directeur général des élections).
La façon dont se sont divisés les partis, au Canada, est très différente de ce qui est observé ailleurs. Ainsi, en France, les mêmes partis se font la lutte chaque fois qu’il y a des élections, peu importe lesquelles.
La spécialisation de chaque parti, au Canada, selon un type d’élections résulte d’un long processus, qui a été impulsé par l’interdiction du « double mandat » en 1874 (signalée précédemment, dans ce texte). La spécialisation a été encouragée par les conflits entre les élus fédéraux et les élus provinciaux d’un même parti, ces derniers réclamant le respect, par les autorités fédérales, de l’exclusivité législative accordée aux provinces par le Constitution. De plus, très tôt dans l’histoire de la fédération, les équipes provinciales libérales (ou conservatrices) ont attiré des personnes qui s’intéressaient aux écoles ou aux hôpitaux, aux travaux de voirie, au commerce des vins et alcools ou à d’autres sujets relevant de l’autorité des provinces, alors que les équipes fédérales de même appellation (libérales ou conservatrices) ont recruté des gens des banques, des dirigeants de grandes entreprises, des avocats œuvrant dans des secteurs réglementés par les autorités d’Ottawa et d’autres personnes préoccupées par les questions d’envergure pancanadienne plutôt que par les objets des lois provinciales.
Les chefs des partis représentés à Ottawa ont voulu imposer à leurs militants des consignes uniformes, car le désastre attendait le parti dont les porte-parole auraient affirmé une chose à Montréal et son contraire à Toronto. Ces consignes uniformes étaient souvent incompatibles avec les revendications régionalistes des parlementaires provinciaux de la même appellation et ces derniers, les uns après les autres, ont préféré s’affranchir, si bien que, pendant un temps, plusieurs organisations partisanes, tant chez les libéraux et que chez les conservateurs, ont été dominées par les parlementaires provinciaux.
Avec l’adoption du suffrage universel des hommes et des femmes (qui a plus que doublé le nombre des électeurs), à la fin de la Grande Guerre de 1914-1918, les organisateurs d’élections ont dû recruter de très nombreux bénévoles et ils ont découvert que beaucoup voulaient s’engager uniquement pour un type d’élections, le taux de roulement des bénévoles étant, de toute façon, très élevé.
La différenciation, entre les équipes, a été accentuée dans les provinces dont les circonscriptions provinciales, plus nombreuses que les circonscriptions fédérales, avaient des contours qui ne coïncidaient pas avec ceux des circonscriptions fédérales.
C’est dans ce contexte qu’ont été créés les premiers principaux partis provinciaux d’appellations distinctes de celles des partis fédéraux. Quelques-uns de ces partis provinciaux ont pris le pouvoir dans certaines provinces. L’Ontario a eu un gouvernement des Fermiers unis de l’Ontario de 1919 à 1923. L’Alberta a eu un gouvernement des Fermiers unis de l’Alberta de 1921 à 1935 puis un gouvernement du Parti du crédit social de 1935 à 1971. Les Fermiers unis du Manitoba ont obtenu 28 des 55 sièges à l’assemblée de Winnipeg en 1922 et leur chef, John Bracken, a été Premier ministre du Manitoba jusqu’en 1943. La Saskatchewan, en 1944, a donné la victoire à un parti qui avait été créé en 1932 ; ce parti est resté au pouvoir, en Saskatchewan, jusqu’en 1964. La Colombie-Britannique a été dirigée, de 1953 à 1972, par le Parti du crédit social. Au Québec, à plusieurs reprises, après 1936, le gouvernement a été formé par un parti (l’Union nationale) qui n’avait aucun lien organique avec les libéraux ou les conservateurs d’Ottawa. Il est arrivé que l’Assemblée, à Edmonton (capitale de l’Alberta), ne compte aucun libéral ou aucun conservateur. La même chose s’est produite en Colombie-Britannique, pendant des années, de même qu’en
Saskatchewan et au Manitoba (où aucun libéral n’a pu être élu après 1932, jusqu’aux élections de 1962).
Le processus de différenciation s’est achevé avec les réformes apportées aux lois électorales provinciales après 1960. En forçant les partis à se doter d’une comptabilité et à produire des rapports décrivant leurs revenus et leurs dépenses, puis en proposant aux partis des financements publics, les dispositions nouvelles ont entraîné une réorganisation des ailes provinciales des partis canadiens qui n’avaient pas encore acquis leur complète autonomie.
Aujourd’hui, chacun des principaux partis provinciaux est le défenseur des intérêts de la province où il est implanté. Certains de ces partis ont même poussé très loin leur « différence » (cas du Parti québécois et du Saskatchewan Party, notamment).
Parce que de nombreux partis provinciaux ont des appellations qui ressemblent à celles des partis fédéraux, les gens qui n’ont jamais vécu la politique réelle du Canada peuvent s’imaginer qu’un parti provincial d’appellation libérale est nécessairement une filiale du Parti libéral du Canada (et ainsi de suite pour d’autres partis provinciaux par rapport aux autres partis fédéraux). Beaucoup de Canadiens qui n’ont pas milité dans les partis peuvent même le croire, mais la fréquentation des gens qui sont très impliqués dans la vie politique leur ferait voir ce qui est, vraiment, une grande particularité du système politique du Canada.
Certes, certaines personnes militent à la fois dans un parti fédéral et un parti provincial, et de nombreux électeurs se disent libéraux (ou conservateurs) à la fois aux élections fédérales et aux élections provinciales, mais il n’empêche que, dans les faits, les statuts des partis sont distincts, les organisations sont différentes, les dirigeants ne sont pas les mêmes, et, surtout, les enjeux changent selon les contextes.
Les enjeux auxquels s’intéressent les partis politiques, au Canada, correspondent, pour l’essentiel, aux particularités du territoire où chacun d’eux opère, dans le cadre imposé par le fédéralisme. Ces enjeux ne correspondent pas souvent à la distinction que l’on fait dans plusieurs pays européens (en France, notamment) entre la droite et la gauche. De fait, contrairement aux pays du continent européen, le Canada n’a pas eu de partis communistes ou de partis fascistes capables de faire élire plus d’un député. Certes, il y a eu, lors de quelques élections, certains candidats qui se sont présentés comme socialistes ou comme travaillistes, mais la plupart ont été défaits.
Le fédéralisme, l’hétérogénéité des populations qui se reflète sur la représentation graphique du territoire, les énormes distances entre les diverses zones habitées du pays, les différences très marquées dans les activités qui distinguent les diverses régions (pêche, production de céréales, industrie laitière, élevage, forêts, mines, pétrole, industrie manufacturière, etc.), les contrastes entre l’Atlantique, le Pacifique, l’Arctique et, au Sud, la frontière avec les États-Unis d’Amérique, et bien d’autres choses encore posent aux partis du Canada des défis particuliers, différents de ceux qui se posent dans les pays d’Europe.
Parmi les partis représentés à la Chambre des communes du Canada, il en est deux qui se partagent habituellement 75% des voix exprimées lors des élections, encore que cela n’a pas été le cas lors des élections de 2004 et de 2006, puisque les deux principaux partis n’ont eu alors, ensemble, que deux tiers des voix. Ces deux grands partis fédéraux, celui des libéraux et celui des conservateurs, se distinguent des autres, appelés « tiers partis », non seulement parce que leurs candidats obtiennent beaucoup de voix mais aussi parce qu’ils ont des élus dans toutes les régions du pays. Ces deux grands partis pancanadiens ont alterné au pouvoir depuis 1867, année des premières élections à la Chambre des communes du Canada (élections appelées « élections
fédérales » ).
Les conservateurs, au pouvoir pendant 25 des 30 premières années de l’histoire de la fédération canadienne, ont eu un principal projet, celui de relier par un chemin de fer le port d’Halifax, sur l’Atlantique, à Vancouver. Ce grand projet, démesuré pour un pays qui ne comptait encore que trois millions d’habitants, a été réalisé à force de compromis et de promesses, et dans une perspective de concurrence avec les Etats-Unis d’Amérique. Il a engagé l’industrialisation du Canada et facilité la vente de ses ressources au Royaume-Uni, surtout, et aux autres pays de ce qui était encore l’Empire britannique.
Les libéraux, qui ont pris le pouvoir à Ottawa en 1896, ont, pendant quelques années, favorisé les autorités des provinces qui faisaient alors face à d’importantes difficultés financières et soutenu une politique de bonne entente commerciale avec les États-Unis d’Amérique. Ils ont bénéficié, pendant longtemps, de la faveur des francophones qui mettaient en eux des espoirs qui n’ont pas été satisfaits et ils ont profité, aussi, du soutien électoral des immigrants du continent européen qui, eux, ont eu une grande influence. Les libéraux, comme les conservateurs, ont perdu, depuis une quinzaine d’années, une partie de leurs appuis d’antan, au profit des petits partis (les tiers partis fédéraux), lesquels, on l’a vu, ne participent jamais au gouvernement du Canada même s’ils ont des députés à la Chambre des communes.
Au Canada, autre distinction à noter, les partis ont abandonné depuis longtemps la mainmise qu’ils avaient jadis sur la délimitation des frontières des circonscriptions électorales et sur la gestion des élections, lesquelles sont, aujourd’hui, très étroitement réglementées. Quand on les compare à celles de certains autres pays, les lois qui encadrent les élections à l’assemblée de chacune des provinces (en particulier celles du Québec) comme celles qui concernent les
élections à la Chambre des communes du Canada peuvent paraître exemplaires à bien des égards (en particulier quant au contrôle du scrutin et au financement des partis). Néanmoins, le scrutin uninominal traditionnel (à un tour) que ces diverses lois électorales perpétuent génère des inégalités de représentation très souvent dénoncées, mais que les autorités estiment moins inquiétantes que les conséquences de la « représentation proportionnelle », assez répandue en Europe, ou que le scrutin à deux tours que connaît la France.
Le mode de scrutin appliqué au Canada a donné de longues périodes de stabilité institutionnelle, les détenteurs des postes d’autorité obtenant, grâce à lui, des majorités parlementaires que n’aurait pas permises la représentation proportionnelle. Au terme des considérations qui précèdent, il devrait être établi que la façon dont les partis politiques sont divisés, au Canada, est atypique, et différente de celle que l’on observe en France.
Conclusion
Le caractère atypique de l’ensemble constitué par les partis politiques au Canada mène à voir le poids considérable de la géographie et de la démographie sur le système politique canadien. Les particularités du système politique du Canada résultent en effet, dans une large mesure, de l’immensité et de la diversité du territoire ainsi que de l’hétérogénéité de la population. Ces particularités commandent, pour que règne la démocratie, une organisation fédérale des pouvoirs et, comme le pensent encore beaucoup de Canadiens, une large autonomie des institutions législatives des provinces dont les populations réclament des politiques « distinctes ». Le type de fédéralisme qui se pratique au Canada est assurément la plus remarquée de ses particularités.
Avec ses 9 975 000 kilomètres carrés, le Canada est le deuxième plus vaste pays du monde, après la Russie (17 075 000 kilomètres carrés) et tout juste avant la Chine (9 600 000 kilomètres carrés) ; pour faire image, on peut rappeler que le territoire du Canada est dix-sept fois plus étendu que celui de la France. On peut comprendre que la géographie du Canada impose à ce pays autre chose qu’un régime unitaire comme en ont quelque 180 pays.
Quant à la démographie, elle fait penser à une mosaïque. Le Canada est un pays peuplé, pour l’essentiel, d’immigrants et de descendants d’immigrants, qui ne se sont pas entièrement fondus dans un vaste ensemble relativement uniforme, contrairement à ce que beaucoup auraient souhaité. Il en résulte une hétérogénéité très grande que le système politique canadien exprime de maintes façons, comme on vient de le voir.
Cette hétérogénéité donne au Canada des possibilités enviables. En effet, en raison des origines de ses habitants, le Canada s’est beaucoup impliqué dans la coopération internationale et en particulier dans deux ensembles de pays, ceux du Commonwealth britannique (53 pays y compris le Canada) et ceux de la Francophonie (46 pays auxquels s’ajoutent quelques États fédérés). En raison de sa place au sein du Commonwealth et au sein de la Francophonie, en raison aussi de sa participation à d’autres organisations internationales, et parce que son histoire ne l’accable pas et qu’il est en paix avec son unique voisin d’Amérique du Nord, le Canada est l’un des rares pays du monde qui peuvent, aujourd’hui, paraître comme « amis de tous ».
La population du Canada, forte de 32 millions de personnes, est l’une de celles qui, dans le monde, bénéficient des droits et libertés les plus larges ; de fait, rares sont les populations qui, comme celle du Canada, sont protégées par une loi constitutionnelle aussi respectueuse des particularités individuelles que l’est la Charte canadienne des droits et libertés.
Même s’il se distingue de celui de la France, le système politique du Canada a beaucoup en commun avec lui. Comme en France, ses institutions sont celles d’une société de droit. Leur fonctionnement est fondé sur le principe de la primauté du droit, d’un droit qui garantit l’égalité juridique des membres de la société, qui garantit en outre certaines libertés individuelles, dont la liberté de conscience et de religion, et la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Ces institutions, aujourd’hui, sont dites démocratiques, parce qu’elles sont dirigées par des personnes qui doivent leur poste aux choix exprimés lors d’élections pluralistes et fréquentes, auxquelles peuvent participer tous les citoyens des régions concernées, qui ont l’âge de voter et qui n’ont pas été condamnés pour une fraude électorale.
Copyright : L’Harmattan-2008
Pour en savoir plus : Bernard A., 2005, Vie politique au Canada, Québec, Presses de l’Université du Québec, 466 p.
Initialement mis en ligne le 8 octobre 2008
Table des matières de l’ouvrage dont est extrait ce texte
LA SOCIETE CANADIENNE EN DEBATS WHAT HOLDS CANADA TOGETHER ?
A. Faure et R. Griffiths (dir.), L’Harmattan, 2008
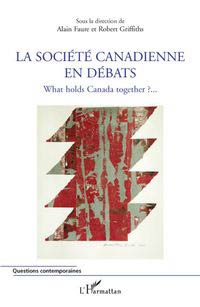
INTRODUCTION GENERALE : LE DOUBLE IMPENSE DE LA CANADIAN ATTITUDE
Alain Faure
PREMIERE PARTIE : FONDATIONS & REPERES
FONDATIONS HISTORIQUES ET IDENTITAIRES : TO BE OR NOT TO BE CANADIAN
Jean Tournon
LES HERITAGES BRITANNIQUES AU CANADA. UNE RECONNAISSANCE DIFFICILE
Robert Griffiths
LE SYSTEME POLITIQUE CANADIEN ET SES PARTICULARITES
André Bernard
DYNAMIQUES PARTISANES ET ELECTORALES AU CANADA
Pierre Martin
LE MULTICULTURALISME INSTRUMENT DE COHESION SOCIALE ?
Sandrine Tolazzi
AMERINDIENS ET CANADIENS : APORIES DE LA TUTELLE ET DE LA RECONCILIATION
Hélène Greven-Borde
SECONDE PARTIE : CONTROVERSES & CHANTIERS
QU’EST-CE QUI FAIT TENIR LE CANADA ENSEMBLE ? ROAD MOVIE D’EST EN OUEST
Martin Vanier
LES EDIFICES-PAYS CANADIEN ET ESPAGNOL AU BANC D’ESSAI
Yolaine Cultiaux
CANADIAN VERTIGO
Elena Varecy
UN PATRIMOINE AU SERVICE DE L’UNITE CANADIENNE
Stéphane Héritier
CULTURE DE L’ARCTIQUE, IDENTITE NATIONALE ET ENJEUX CIRCUMPOLAIRES
Cécile Pelaudeix
LE MULTICULTURALISME : AU SERVICE DU PEUPLE OU DE L’ELITE ?
Eric Tabuteau
MEDIA, NATIONALISME ET COHESION DANS LA REVOLUTION TRANQUILLE
Antoine Faure
CONCLUSION GENERALE : L’IMAGE DU CANADA ET LES ENJEUX DE L’AVENIR
Robert Griffiths
LISTE DES AUTEURS & RESUMES/ABSTRACTS
Pour ne rien rater de nos nouvelles publications, abonnez-vous à la Lettre du Diploweb !
Direction

Directeur, P. Verluise
Conseil scientifique
Mentoring et coaching géopolitique
Présenter le Diploweb.com
Charte du site
Auteurs
Proposer un article
Retrouvez la chaîne Diploweb sur :











