Géopolitique du Printemps arabe. Dans le cadre de son partenariat avec La documentation Française, le Diploweb.com est heureux de vous présenter cet extrait de l’ouvrage dirigé par Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff, Afrique du Nord et Moyen-Orient 2012-2013. Printemps arabe : trajectoires variées, incertitudes persistantes, Coll. Mondes émergents, Paris, La documentation française, 2012. Le texte complet de cet article, publié sous ce même titre se trouve pp. 35-47.
LES mois qui se sont écoulés entre le début de l’année 2011 et le printemps 2012 ont changé pour longtemps l’insertion du Moyen-Orient et de la Méditerranée dans les relations internationales. Dans le débat public mondial, l’image d’une révolution démocratique déferlant sur le monde arabe au point de faire trembler les régimes autoritaires de la région, voire du reste de la planète, a fait place à celle d’un monde arabe largement submergé par une vague islamiste d’autant plus inquiétante pour l’Occident libéral que celle-ci se fondait sur d’amples victoires électorales, signifiant par là même qu’elle répondait à une demande sociale forte. Chacune de ces deux images est réductrice. Au-delà de ce champ de perceptions extérieures, une fois mises de côté les dénonciations tardives (« Pourquoi avoir si longtemps fermé les yeux sur des dictatures ? ») ou les prophéties conservatrices (« Vous verrez que nous les regretterons »), reste la nécessité politique de s’adapter à une série d’évènements au déroulement encore inachevé, mais à la portée déjà majeure. Reste donc, au-delà du discours, le choix entre la posture de spectateur, d’empêcheur ou d’accélérateur [1].
Il ne s’agit naturellement pas là uniquement d’une question d’éthique ou de choix intellectuel. Que l’on soit à Washington, Paris, Moscou, Pékin, New Delhi, Pretoria, Téhéran, Tel-Aviv, Ankara ou Ryad, des intérêts sont en jeu. Des pressions internes sont à l’oeuvre. Des craintes s’avivent ou des stratégies se recomposent. Des politiques étrangères doivent donc s’adapter à cette nouvelle donne. Celle-ci a évolué selon plusieurs séquences. La première fut caractérisée par la double révolution tunisienne et égyptienne, qui a imposé aux puissances de produire un discours en réaction à ces événements inattendus. C’était le temps de la recomposition diplomatique. La seconde fut marquée davantage par des événements entraînant la question de l’intervention extérieure, sa dimension militaire et ses conséquences. Les événements de Libye, de Syrie, dans une moindre mesure du Bahreïn, ouvrirent le temps de la recomposition stratégique. Enfin, des questions politiques transversales, qui ne sont pas nouvelles dans la région, furent exhumées une nouvelle fois, mais avec des paramètres désormais inédits. La question de l’intégration des acteurs religieux dans une vie politique démocratique, celle d’un réel acteur politique arabe sur la scène internationale, celle enfin de la guerre et de la paix dans la région, trouvent là une nouvelle acuité [2].
Après la Tunisie et l’Égypte : recompositions diplomatiques
Les soulèvements tunisien et égyptien, qui aboutirent rapidement à la destitution de deux chefs d’État alliés de l’Occident et apparurent comme les signaux de départ d’une série de séismes politiques au sud et à l’est de la Méditerranée, sont survenus dans un contexte international particulier. À l’échelle globale, le « moment unipolaire » du début des années 1990 avait laissé la place, au début des années 2010, à une compétition politique relancée par la montée en puissance chinoise, le renouveau nationaliste russe, les initiatives politiques issues des pays émergents [3]. Ce pluralisme retrouvé de la scène internationale, même s’il ne dégage encore aucun acteur véritablement en mesure de défier la puissance américaine, place les États-Unis dans une situation concurrentielle très éloignée de celle qui les avaient vus, en 1991 (Irak), en 2001 (Afghanistan) et en 2003 (Irak encore), saisir des fenêtres d’opportunités pour lancer des initiatives militaires au Proche-Orient et à ses confins. Il survient par ailleurs à un moment de l’histoire où les États-Unis, comme leurs alliés européens, subissent une crise économique qui atténue leur capacité à s’ériger en modèle de gouvernance, tout en leur imposant de considérer la projection de leur influence dans le monde avec un budget contraint. Si l’élection de Barack Obama, en novembre 2008, avait permis aux États-Unis de tourner la page néoconservatrice qui avait suscité un anti-américanisme record dans le monde arabe [4], et si l’Union européenne (UE) avait tenté, la même année, de refonder sa relation à la Méditerranée par la création de l’Union pour la Méditerranée (UPM), ces deux acteurs allaient aborder les révolutions arabes en partie amoindrie par cette contrainte financière. Pour les États-Unis, en particulier, le coût aussi bien économique que politique et symbolique de dix années de guerre en Afghanistan et de huit en Irak, deux conflits desquels l’Amérique s’efforçait désormais de s’extirper, rendait très peu opportune toute nouvelle aventure politique dans la zone.
Sur le plan régional, les deux bouleversements tunisien et égyptien arrivaient également dans un moment d’impasse politique arabe, face entre autres à la stagnation du processus de paix israélo-palestinien, aux blocages gouvernementaux libanais, et au vieillissement de plusieurs régimes politiques. Dans cette configuration, l’initiative en matière de politique étrangère, depuis plusieurs années, semblait revenir bien davantage aux acteurs non arabes (Iran, Turquie, Israël) qu’aux acteurs qui avaient jadis été les piliers ou les clefs du système d’équilibre régional, comme l’Égypte, la Syrie, l’Arabie Saoudite [5], ou plus loin l’Algérie voire la Tunisie [6]. Dotée de peu de moteurs politiques ou diplomatiques nationaux, la scène politique arabe était encore faiblement structurée sur le plan des institutions collectives, avec une Ligue arabe peu active, un Conseil de coopération du Golfe (CCG) réduit aux monarchies pétrolières organisées autour de l’Arabie Saoudite, ou une Union du Maghreb arabe plongée dans un sommeil profond. Divisée par la deuxième guerre du Golfe (19901991), humiliée par la troisième (à partir de 2003), cette communauté politique arabe comptait en 2011 quelques alliés notoires de l’Occident (au premier rang desquels figuraient l’Égypte et la Tunisie), d’autres qui avaient autrefois capitalisé sur leur posture réfractaire à ce même Occident mais avaient récemment tenté un rapprochement (parmi lesquels la Libye et la Syrie), d’autres encore qui conservaient de bonnes relations avec les États-Unis, mais étaient soupçonnés d’ambiguïté, comme l’Arabie Saoudite depuis 2001, ou le Qatar plus récemment. Les soulèvements survenus en 2011 allaient rendre cette typologie caduque, pour amorcer plusieurs réajustements.
Aux États-Unis, d’abord, la disparition d’Hosni Moubarak, chassé par la révolution égyptienne, privait Washington d’un allié docile, qui acceptait de donner la priorité à l’agenda américain [7]. Accordant un soutien fort, rapide et public à la démocratisation du pays, lâchant donc de fait le régime sortant, l’Amérique a dû ensuite gérer la dégradation de son image (du fait des liens entretenus lors d’une ère désormais révolue) [8], la victoire électorale des Frères musulmans et des salafistes, ainsi qu’un nombre croissant d’incidents [9]. Plus globalement, l’administration Obama ne peut que craindre l’instabilité du plus peuplé des pays arabes, proche allié depuis les années 1970, bénéficiaire d’une importante aide américaine (y compris militaire), premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël, et dont la modération extrême, ces dernières années, avait permis d’éloigner le spectre d’une nouvelle coalition arabe contre l’État hébreu. Sans imaginer encore la remise en cause des accords de Camp David ni un aventurisme irraisonné des nouvelles autorités du Caire, la poursuite des manifestations violentes dans le pays, le climat d’instabilité institutionnelle, le flou persistant sur la réalité de l’identité des futurs interlocuteurs égyptiens (du fait d’une absence de délimitation claire des pouvoirs du président élu, et après l’annulation des élections législatives), constituent une source d’inquiétude, là où il y avait précédemment le sentiment d’un front durablement apaisé. Au-delà de l’Égypte, c’est l’ensemble de l’équation moyen-orientale des États-Unis qui doit être revu, dans la mesure où le pari a été fait d’un soutien sans faille [10] à un changement de régime obtenu après des manifestations de rue et aboutissant à une victoire électorale des acteurs religieux, sachant que le premier point déplaît fortement à certains des alliés arabes de Washington (comme l’Arabie Saoudite), et le second à l’allié israélien.
Washington a néanmoins donné l’impression, tout au long des premières séquences du Printemps arabe, de réagir rapidement, concrètement et avec cohérence aux événements, en soutenant sans réserve l’évolution vers la démocratie. Tel n’a pas été le cas des Européens. Reconnaissant rapidement l’erreur qui avait été la sienne de voir toujours dans les régimes partenaires du Sud méditerranéen des facteurs de stabilité et de sécurité, l’UE a réagi suivant les deux axes dont elle est coutumière : la production de discours et l’annonce d’une aide financière. Dès le 8 mars 2011, Catherine Ashton, haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité pour l’UE, proposait un « partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée », qui prônait une vie politique participative, la dignité, des emplois et le respect des valeurs universelles. Le 25 mai suivant, c’est une « stratégie à l’égard d’un voisinage en mutation » qui était encore avancée. Une aide concrète a donc été promise [11], mais qui demeurait lourde d’insuffisances. Trois lacunes au moins apparaissaient.
1. En dépit de sa volonté d’encourager verbalement les transitions démocratiques, l’Europe s’est contentée d’émettre des souhaits ou des espoirs, de façon peu politisée, saluant une « opportunité », annonçant de nouvelles « perspectives », mais sans tenir compte pleinement du fait que sa proximité géographique par rapport à la région concernée l’obligeait à entrer davantage dans le détail [12].
2. Ce faisant, l’Europe courait le risque d’aller dans la direction que le Sud méditerranéen critique le plus, à savoir celle d’une série de créations de cadres plutôt que de contenus, remémorant le décevant processus de Barcelone après 1995, ou une UPM rapidement devenue caduque devant la succession d’événements dramatiques survenus dans la région (en particulier l’opération israélienne Plomb durci à Gaza, durant l’hiver 2009). Il était difficile d’oublier en effet, en 2011, que H. Moubarak avait été choisi pour coprésider l’UPM trois ans plus tôt, ou que l’ancien président de la Tunisie Zine el-Abidine Ben Ali était un partenaire privilégié des Européens. Le simple ajustement d’instruments déjà existants pouvait donc apparaître comme une réponse bien timide aux événements [13].
3. Dans leur effort insuffisant pour saisir la dimension politique et exceptionnelle de cette situation, les Européens n’étaient pas unanimes sur les orientations à prendre. À ceux qui souhaitaient une prise de position politique claire, s’opposaient ceux à qui le passé interdisait une posture trop péremptoire. La situation nécessitait davantage qu’une intensification des directions déjà explorées. C’est l’ensemble du cadre euroméditerranéen pensé depuis plus de quinze ans qui venait de voler en éclats.
La France, en particulier, a souffert dans la gestion de cette première séquence des soulèvements arabes. Après les maladresses initiales de son approche des événements tunisiens [14] – épisode qui a amené le remplacement d’un ministre des Affaires étrangères –, Paris s’est engagé dans une action militaire de premier ordre en Libye, vers une posture diplomatique de pointe face au drame syrien (voir infra), et plus généralement vers un discours clair de soutien aux droits de l’homme et à la transition démocratique [15]. Pour autant, un soutien restait apporté à ceux des régimes qui n’avaient pas été renversés, en particulier, au Maghreb [16]. En avril 2011, le nouveau ministre des Affaires étrangères Alain Juppé estimait que les réformes annoncées par Abdelaziz Bouteflika en Algérie allaient « dans la bonne direction », et avait salué un mois plus tôt les processus de réforme engagés au Maroc, comme « courageux et responsables » [17]. Après une séquence difficile pour sa diplomatie régionale (obstacles rencontrés par l’UPM, résultats décevants des efforts pour exercer une influence sur Israël au moment de la crise de Gaza en 2009 comme sur le Liban lorsque ce pays se trouvait dans une impasse politique en 2007-2009, revers commerciaux dans le Golfe…), la France était donc amenée à faire preuve de prudence. Conspuée pour avoir trop tardé à prendre la mesure des événements tunisiens, accusée à l’inverse (souvent par les mêmes…) d’avoir voulu être trop en pointe dans le dossier libyen, elle devait, comme d’autres, trouver les bons équilibres diplomatiques pour répondre à des situations inédites. Sur les terrains libyen et syrien, la nature des dilemmes allait largement dépasser cette seule dimension diplomatique.
Après la Libye et la Syrie : recompositions stratégiques
Si les soulèvements tunisien et égyptien ont trouvé leur dénouement sans intervention extérieure majeure, la Libye et la Syrie ont amené la communauté internationale à rouvrir des débats délicats sur la responsabilité de protéger ou sur l’intervention humanitaire [18]. La différence de traitement entre ces deux dossiers, surtout, pose question : tandis que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) intervenait militairement en Libye, précipitant le renversement du colonel Mouammar Kadhafi, la Syrie présentait des conditions d’intervention plus difficiles, qui ont empêché d’envisager sérieusement une telle éventualité. Moins médiatisé, le cas du Bahreïn [19] n’a, quant à lui, suscité que l’expression d’une inquiétude verbale dans les chancelleries occidentales. À mesure que les soulèvements arabes se multipliaient et donnaient lieu à des crispations violentes et durables, les puissances extérieures se trouvaient confrontées à un triple défi concernant leur capacité d’intervention, le maintien de la cohésion de la communauté internationale, et la gestion d’un nouveau paysage stratégique.
Sur ces trois points, l’intervention occidentale en Libye présente un bilan mitigé. Succès militaire dans la mesure où elle a abouti au renversement du colonel Kadhafi, elle a permis de constater néanmoins, avec le recul, les nombreuses limites de ce type d’opération. En premier lieu parce que la France et le Royaume-Uni, qui ont souhaité mener cette intervention et constituent de loin les deux premières puissances militaires européennes [20], ont dû avoir recours à l’allié américain [21] pour défaire une armée libyenne de second rang. Ensuite parce que, en dépit du soutien initial de la Ligue arabe et de certains de ses membres [22], l’aventure libyenne est apparue comme finalement otanienne, sans pour autant faire l’unanimité au sein des membres de l’alliance, puisque huit d’entre eux seulement ont participé aux opérations, puisque, de surcroît, des pays européens importants comme l’Allemagne et la Pologne s’y sont opposés [23], puisque, enfin, un malentendu subsiste entre Européens et Américains sur leur complémentarité affichée dans cette crise.
Pour le Vieux Continent, en effet, à commencer par Paris et Londres, il s’agissait d’une initiative européenne à laquelle les États-Unis ont contribué, dans une dynamique vertueuse montrant à la fois la capacité des Européens à se saisir de tels enjeux, l’accord de Washington pour jouer le jeu du leadership from behind (ou position de retrait permettant de piloter une partie des opérations tout en laissant l’initiative aux alliés européens). De l’autre côté de l’Atlantique, en revanche [24], on fait le constat de l’absence de l’UE en tant que telle dans ce dossier, de l’incapacité des principales puissances européennes à se passer de l’appui militaire américain [25], et on rejette fermement, surtout du côté républicain, ce concept de leadership from behind [26] . En dépit de ces désaccords, c’est bien un label occidental et otanien qui apparaît, ce qui a suscité la défiance d’autres États. Il est frappant, en effet, de constater que le Brésil [27], l’Inde, la Chine et la Russie se sont abstenus sur la résolution 1973. L’Afrique du Sud, qui l’a votée, fut par la suite très critique sur l’interprétation qui en a été faite par les alliés. En d’autres termes, l’affaire libyenne a marqué une défiance des émergents ou des puissances non occidentales, que l’on retrouva bientôt dans le dossier syrien.
En dépit de l’intensité de ce drame syrien, en effet, et du nombre de morts occasionnées par le régime de Damas [28], les leçons tirées de l’opération libyenne empêchent une réponse internationale unanime à cette situation. Aux États-Unis, un débat, animé notamment par un groupe de sénateurs [29], insiste sur la nécessité d’une intervention et, en tout cas, d’un leadership américain fort sur ce dossier, dans lequel la Secrétaire d’État Hillary Clinton s’implique largement [30]. La France a, de son côté, adopté une position en pointe déjà formulée sous Nicolas Sarkozy [31], qui ne s’est pas démentie après la victoire de François Hollande à l’élection présidentielle d’avril-mai 2012. Avec la Turquie (qui accueille des responsables de l’Armée syrienne libre), le Qatar et les États-Unis, Paris soutient le Conseil national syrien lancé en octobre 2011 à Istanbul, a soutenu le plan proposé par l’ancien secrétaire général des Nations unies et médiateur de cette organisation et de la Ligue arabe chargé du dossier syrien Kofi Annan [32], et a accueilli en juillet 2012 une réunion des « Amis du peuple syrien » [33]. Mais deux problèmes majeurs empêchent d’aller au-delà de cette mobilisation diplomatique. D’une part, une opération militaire extérieure serait plus difficile qu’en Libye, compte tenu des moyens de l’armée syrienne et des rapports de force sur le terrain. Non sollicitée par l’opposition syrienne dans un premier temps, elle est apparue ensuite souhaitable aux yeux de certains. Mais on se heurte là au deuxième obstacle : l’absence de mandat onusien pour lancer une telle opération. La Russie et la Chine se refusent, y compris en recourant à leur droit de veto, à voter en faveur d’un tel mandat, dans le cadre du Conseil de sécurité [34]. Au-delà des intérêts de ces deux puissances dans la région, intérêts importants mais non cruciaux [35], c’est tout un type de processus international que Moscou et Pékin souhaitent freiner. Il s’agit en l’occurrence du processus par lequel des puissances occidentales parviennent à transformer rapidement une émotion internationale légitime en intervention aboutissant à un changement de régime dans des pays qui les ont défiées. En cela, le cas libyen a joué un rôle clef dans la perception de ce mécanisme. Le mandat consistant à protéger les populations libyennes a été considéré par la Chine et la Russie comme largement outrepassé, pour révéler son objectif réel, à savoir la destitution du régime en place. Il n’est donc pas question, pour Moscou et Pékin, de laisser se renouveler indéfiniment ce scénario, auquel ils préfèrent un processus de type yéménite [36], qui leur conférerait un rôle plus important.
Par ailleurs, la chute de Bachar al-Assad entamerait une recomposition profonde des équilibres régionaux, à commencer par le lien entre l’Iran, le Hezbollah, le Hamas et différents groupes palestiniens, la situation au Liban, et influerait sur le rôle de la Turquie, alliée des États-Unis, qui pourrait accroître son influence régionale à la faveur de ces événements. Cette recomposition pourrait être, aux yeux des deux puissances non occidentales membres permanents du Conseil de sécurité, favorable à Washington. C’est oublier un peu vite que ce sont d’abord des alliés des États-Unis et de l’Europe qui furent les victimes des premiers printemps arabes, et que si la Turquie reste un pays allié des États-Unis, elle a affiché également depuis peu une posture de plus en plus ferme à l’égard d’Israël. Néanmoins, la question de la recomposition stratégique est bel et bien posée. Le Premier ministre turc R. Tayyip Erdogan, qui avait joué un rôle modérateur dans la situation libyenne [37], avait entamé à la mi-septembre 2011 une tournée triomphale dans les pays de la révolution (Égypte, Tunisie, Libye), où il a signé de nombreux accords de coopération stratégique et traités d’amitié [38]. D’autres acteurs régionaux tentent également, de leur côté, de reprendre la main sur les événements, à l’image de l’Arabie Saoudite avec l’élargissement, imaginé un temps, du CCG au Maroc et à la Jordanie [39]. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni retrouvent quant à eux des marges de manoeuvre sur les dossiers libyen et syrien, qu’ils semblaient avoir perdu en partie après les événements tunisiens et égyptiens.
[…]
Copyright 2012-Charillon/Afrique du Nord Moyen-Orient 2012-2013/Documentation française
Plus
Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff (sous la direction de), Afrique du Nord et Moyen-Orient 2012-2013. Printemps arabe : trajectoires variées, incertitudes persistantes, Coll. Mondes émergents, Paris, La documentation française, 2012.
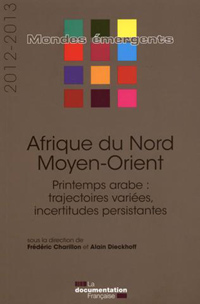
4e de couverture
Le monde arabe a connu depuis janvier 2011 des mouvements de protestation d’une ampleur inattendue qui bouleverse la donne géopolitique régionale. A cette occasion, se sont exprimés un rejet de systèmes autoritaires avec accaparement du pouvoir politique et des richesses, doublée d’une aspiration à d’autres formes de gouvernance, socialement équitables et politiquement éthiques. Ces mouvements spontanés, se traduisent toutefois par des programmes ou des modèles politiques et socio-politiques encore mal structurés. En ce troisième trimestre 2012, les incertitudes demeurent : elles concernent la redéfinition du pacte social, la question de l’État et, plus généralement, le rapport de la nouvelle scène arabe avec le reste du monde.
. Voir une présentation de Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff (sous la direction de), Afrique du Nord et Moyen-Orient 2012-2013. Printemps arabe : trajectoires variées, incertitudes persistantes sur le site de La documentation Française
Pour ne rien rater de nos nouvelles publications, abonnez-vous à la Lettre du Diploweb !
[1] Manon-Nour Tannous (dir.), Le monde face aux révolutions arabes : analyses et réactions des puissances régionales et mondiales, Éditions du Cygne, Paris, 2012.
[2] Pour une vision d’ensemble des facteurs et conséquences des révolutions arabes, voir Farhad Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that Shook the World, Paradigm, Londres, 2012.
[3] L’initiative turco-brésilienne sur le nucléaire iranien, au printemps 2010, en était une illustration. Le rôle croissant de l’Afrique du Sud en est une autre. Voir sur l’Afrique du Sud, Imad Mansour, “South Africa and the Arab Spring : Opportunities to Match Diplomacy Goals and Strategies”, Ifri, avril 2012.
[4] Le discours du président des États-Unis à l’Université du Caire, le 4 juin 2009, avait marqué un nouveau départ pour la diplomatie américaine dans la région, suivi d’une main tendue à l’Iran. Sur l’antiaméricanisme au Moyen-Orient, voir Hadjar Aouardji, L’antiaméricanisme social : cas de l’Égypte, de la Jordanie et de l’Arabie Saoudite, thèse de doctorat en science politique-relations internationales, Paris, Institut d’études politiques, 2010.
[5] Voir Yasmine Farouk, Autonomisation, Accommodement et Wait to Seize : les strategies réactives du triangle arabe après l’intervention américaine en Irak : l’Arabie Saoudite, l’Égypte et la Syrie (2003-2007), thèse de doctorat en science politique-relations internationales, Paris, Institut d’études politiques, 2010.
[6] Du temps où celle-ci accueillait l’OLP de Yasser Arafat (1982-1994), ou le siège de la Ligue arabe, lorsque l’Égypte était exclue de cette organisation après sa paix séparée avec Israël (1979-1990).
[7] L’ambassadeur égyptien à Moscou, Mohamed Alaa al-Hadidi, dans une conférence de presse à l’agence RIA Novosti, a pronostiqué au début de l’été 2012 une politique étrangère égyptienne « plus ouverte » sous la présidence de Mohamed Morsi. « Nous essayerons de développer les relations avec tout le monde et pas uniquement avec les partenaires de l’ancien régime », a déclaré le diplomate.
[8] Pour une étude détaillée, voir Pew Research Center, Obama’s Challenge in the Muslim World. Arab Spring Fails to Improve U.S. Image, 17 mai 2011 (http://www.pewglobal.org/).
[9] Le Conseil suprême des forces armées a annoncé en février 2012 le jugement de 44 personnes dont 19 Américains, accusées de financement illégal d’ONG opérant dans le pays. La secrétaire d’État H. Clinton a réagi vivement, évoquant une révision de l’aide financière américaine au Caire.
[10] En février 2012, la Maison-Blanche a annoncé plus de 800 millions de dollars d’aide économique aux pays concernés par le Printemps arabe et, en parallèle, le maintien de l’aide militaire américaine à l’Égypte, malgré la crise des ONG (voir supra).
[11] 17 millions d’euros pour soutenir la transition démocratique tunisienne, qui seront suivis d’autres sommes à des fins humanitaires au moment des évènements libyens (30 millions d’euros). Par ailleurs, une politique de voisinage a permis d’ajouter 1,2 milliard d’euros aux 5,7 milliards d’aide prévus pour la période 2011-2013, avec des mécanismes financiers plus flexibles pour la période 2014-2020. La Banque européenne d’investissement a proposé 1 milliard d’euros supplémentaires pour les prêts dans la région.
[12] Les questions d’immigration et de liberté de circulation, d’accès au marché européen, ou encore de ressources énergétiques, constituent ainsi des enjeux précis sur lesquels la rive Sud attend des propositions.
[13] Sven Biscop, Rosa Balfour, Michael Emerson, An Arab Springboard for EU Foreign Policy ?, Egmont Papers, no 54, janvier 2012. R. Balfour, EU Conditionality after the Arab Spring, IEMed-Euromesco, Papier no 16, 2012.
[14] Voir notre édition précédente : Afrique du Nord–Moyen-Orient. Révolutions civiques, bouleversements politiques, ruptures stratégiques, coll. « Mondes émergents », édition 2011-2012.
[15] En complément de l’aide annoncée par la Commission européenne à la Tunisie en mars 2011, la France a annoncé, lors du sommet du G8 qui s’est déroulé deux mois plus tard, qu’elle accorderait 1 milliard d’euros à titre bilatéral aux transitions démocratiques de Tunisie et d’Égypte.
[16] Barah Mikail, “France and the Arab Spring : an Opportunistic Quest for Influence”, FRIDE, Madrid, Working Paper, no 110, octobre 2011.
[17] Voir également, un an plus tard, Alain Barluet, « Juppé salue à Rabat le “modèle” marocain », Le Figaro, 9 mars 2012. Le ministre, durant le même séjour, a soutenu la position du Maroc sur la question du Sahara occidental.
[18] Débats qui avaient été relancés en 1991 par la résolution 688 des Nations unies à l’époque de la deuxième guerre du Golfe.
[19] Avec, en mars 2011, une intervention des troupes du CCG, essentiellement saoudiennes, pour mettre fin au soulèvement de populations chi’ites.
[20] Avec près de la moitié du budget de défense de l’UE, et sans aucun doute l’essentiel de son savoir-faire en matière d’intervention.
[21] Sans l’aide militaire duquel les opérations auraient été beaucoup plus difficiles, notamment sur le plan du renseignement et du transport.
[22] La résolution 1973 des Nations unies, permettant une zone d’exclusion aérienne en Libye pour protéger la population civile, et envisageant pour ce faire de « prendre toutes mesures nécessaires », a été présentée par Paris et Londres mais également par le Liban.
[23] Ce refus allemand de voter la résolution 1973 a été très mal reçu en France, où il confirme aux yeux de certains un éloignement stratégique progressif des deux voisins.
[24] Entretiens de l’auteur avec plusieurs think tanks et responsables politiques à Washington, décembre 2011.
[25] Appui qui n’allait pas de soi, tant l’administration Obama était peu désireuse de se lancer dans une telle initiative à l’heure où, comme on l’a dit plus haut, la priorité était au désengagement des conflits du « Grand Moyen-Orient ».
[26] Pour reprendre les termes d’un membre du think tank conservateur American Enterprise Institute, « l’Amérique pilote complètement ou pas du tout, mais en aucun cas “from behind” ».
[27] Comme le souligne Zaki Laidi, « Le Brésil a profité de ces crises pour demander une redéfinition du concept de responsabilité de protéger. Il propose d’y ajouter le principe de responsabilité pendant que l’on protège […] reposant sur l’idée selon laquelle la responsabilité de protéger doit être soumise aux principes préalables de la proportionnalité, du recours à la force en dernier recours et de l’évaluation des conséquences de ce recours à la force. En soi l’idée d’aménager des principes pour éviter des dérives n’est pas forcément une mauvaise chose ». Z. Laidi, « Syrie : le sens du veto russe » (telos-eu.com/).
[28] Voir la contribution d’Ignace Leverrier dans ce volume p. 67.
[29] Les républicains John McCain, Lindsey Graham et Marco Rubio, le démocrate John Kerry, l’indépendant Joe Lieberman en font partie.
[30] Cherchant notamment, selon des informations disponibles en juillet 2012, à obtenir de la Russie l’accueil du président syrien si celui-ci quittait le pouvoir.
[31] Le ministre des Affaires étrangères A. Juppé estimait en février 2012 que le président Assad devait se retirer.
[32] Plan en six points proposé à Damas en mars 2012 : 1. Dialogue politique, 2. Fin de la violence, 3. Aide humanitaire, 4. Fin des détentions arbitraires, 5. Liberté pour les journalistes, 6. Liberté pour les Syriens. Devant la poursuite des violences, K. Annan semblait reconnaître lui-même, en juillet 2012, l’échec de ce plan.
[33] L’ambassade de France à Damas a été fermée le 2 mars 2012. Paris a également déploré la mort de plusieurs journalistes français en Syrie.
[34] Notamment en février 2012 sur un projet de résolution condamnant la répression en Syrie.
[35] La Syrie est l’un des derniers points d’appui de la Russie dans la région, laquelle bénéficie de l’accès au port syrien de Tartous, unique base navale russe en Méditerranée (mais qui accueille peu de personnel). La Chine, quant à elle, reste très impliquée dans les questions énergétiques régionales, dont dépend en partie son approvisionnement en pétrole et en gaz naturel.
[36] C’est-à-dire une transition politique négociée avec les autorités sortantes.
[37] Contribuant à la libération de journalistes américains et britanniques.
[38] Tout en refusant d’encourager ouvertement les partis religieux, en développant un discours qui réaffirmait le caractère laïc de l’État turc. Sur le dossier syrien, Ankara, qui a d’abord cherché à trouver une issue honorable pour le régime de Damas, s’est ensuite exaspérée du manque de concessions du régime, contre lequel la Turquie a fini par adopter des sanctions. La question kurde, l’économie des villes du Sud-Est proches de la frontière syrienne, la question des réfugiés syriens en Turquie constituent des enjeux majeurs dans ce dossier. La destruction d’un avion turc, le 22 juin 2012, par la défense aérienne syrienne, a achevé d’éloigner les deux pays l’un de l’autre.
[39] Mehran Kamrava, “The Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution”, Orbis, vol. 56/1, hiver 2012, p. 96-104.











