L’Afghanistan, État pachtoun dans l’esprit de son fondateur en 1747, avait bien vocation à être un État-nation composite, les nations non pachtounes ayant clairement exprimé leur « vouloir-vivre ensemble » par deux siècles de combats aux côtés des tribus, pour sécuriser un territoire commun et indépendant des Empires voisins. Mais l’Afghanistan, situé au centre du partage des grands Empires, n’a jamais trouvé la respiration nécessaire pour structurer un État moderne et apaisé. Les guerres coloniales se sont soldées par une amputation de territoire et la division de la nation fondatrice du pays, et le "Grand jeu" a encore connu deux dramatiques rebondissements, l’un en 1979 par l’invasion soviétique, l’autre depuis 2001… Il ne reste plus grand-chose des espoirs qu’avait fait naître le long règne sans guerre (1933-1973) du roi Zaher Shah et la promulgation de la Constitution de 1964.
Alors que beaucoup s’interrogent sur les perspectives de l’Afghanistan, le site géopolitique Diploweb.com est heureux de vous proposer dans le cadre de ses synergies géopolitiques le chapitre publié par Georges Lefeuvre sous le titre "Afghanistan" dans l’ouvrage dirigé par Joao Medeiros, Le mondial des nations. 30 chercheurs enquêtent sur l’identité nationale, Paris, Choiseul, 2011, pp. 222-239.
Af-pak
Dès l’accession de Barack Obama à la présidence des États-Unis, en janvier 2009, un néologisme apparaît dans le jargon politique du Département d’État, puis dans celui des institutions de l’onu et de l’Union européenne : « Af-pak ». Ce télescopage linguistique d’« Afghanistan » et de « Pakistan » n’est pas forcément bien ressenti par Kaboul et Islamabad, les deux capitales respectives des deux États voisins et souverains, mais il indique surtout que le monde prend enfin conscience que les insurrections de type taliban et les foyers du terrorisme international de type Al-Qaïda ne sont plus contenus dans l’espace et les compétences de l’un ou l’autre des deux États concernés, mais se développent dans la complexe alchimie de peuples à forte conscience identitaire, des deux côtés d’une même frontière. Doit-on pour autant opposer d’emblée le concept de nation à celui d’État dans la zone concernée ? Ce n’est pas si simple, mais il est certain qu’on ne peut traiter de la thématique « nation » pour le seul Afghanistan sans y associer le Pakistan, ou au moins ses provinces baloutches et pachtounes de l’ouest.
Les peuples qui occupent l’espace afghan et l’ouest du Pakistan ont vécu ensemble des grandes épopées de l’histoire, mais la genèse de l’État afghan, en 1747, n’a rien à voir avec celle de l’État pakistanais, exactement deux siècles plus tard, en 1947. Il en résulte beaucoup de confusions ou des niveaux de consciences nationales très variés, qui s’expriment à l’intérieur de chaque entité d’État et perturbent aussi leurs relations bilatérales. Cependant, quelles que soient les définitions que l’on donne au mot nation, il s’en trouvera une qui s’appliquera. Ainsi, la forte identité nationale du peuple pachtoun, historiquement et démographiquement dominant en Afghanistan, n’exclut pas, malgré les apparences, une autre définition plus large et plus composite d’une « nation afghane », au sens où l’entendait Ernest Renan [1], puisque des peuples d’origines et de cultures très différenciées ont été amenés, dans des circonstances historiques que nous exposerons, à s’entendre sur un « vouloir-vivre ensemble », dans les limites d’un même territoire indivisible. Mais le cours mouvementé des deux derniers siècles n’aura jamais permis à l’État afghan d’atteindre la maturité nécessaire à la structuration de cette volonté commune.
Toute différente est la situation du Pakistan, jeune État-nation qui, au moment de sa fondation, disposait d’autant de facteurs d’intégration que de désintégration des peuples réunis sous sa bannière. 63 ans plus tard, la réussite n’est pas au rendez-vous, pour des raisons multiples que nous tenterons ici d’analyser, et les forces centrifuges n’affectent pas seulement les provinces pachtounes et baloutches à l’ouest de l’Indus, mais aussi la zone séraïkiphone au centre-est du pays où des militants nationalistes aspirent à se séparer des provinces du Pendjab et du Sind et à accéder à un statut d’autonomie. La plupart des Baloutches, beaucoup de Pachtouns et quelques Seraïkis et Sindhis se retrouvent dans le Pakistan Oppressed Nations Movement (ponam) [2].
Enfin, aux définitions habituelles mais séculières du concept de nation, s’ajoute une autre définition d’ordre exclusivement religieux qui, dans sa formulation modérée, a certes entretenu des ambiguïtés entre États et nations de la région, mais qui, dans sa forme la plus catégorique, nourrit l’idéologie des groupes terroristes les plus radicaux de Al-Qaïda, enkystés dans les zones tribales pachtounes entre Afghanistan et Pakistan.
Afghanistan
Parler d’une mosaïque des peuples à propos de l’Afghanistan est devenu un lieu commun, mais la vraie question, souvent éludée, est de savoir comment et pourquoi cette mosaïque s’est retrouvée un jour contenue dans la nasse d’un même État. Les peuples de cette mosaïque ont-ils chacun une conscience identitaire différenciée ? Si oui, qu’ont-ils en partage qui aurait fait naître, au-dessus des disparités, le sentiment d’appartenir à une même nation afghane ? Et l’État afghan d’aujourd’hui répond-il aux aspirations de toutes les facettes de la nation ?
Les Empires de l’Orient médiéval ne s’imposent pas de limites territoriales, contrairement aux États modernes dont l’étymologie [3] indique le souci de stabilité et de pérennité, tant des frontières que des institutions. Les Empires connaissent successivement des expansions et des rétrécissements, au gré des conquêtes victorieuses ou repoussées ; les conquérants déplacent des peuples soumis et les abandonnent souvent en cas de retraite. Or, la zone géographique qu’on appelle aujourd’hui Afghanistan est, plus qu’aucune autre, à la croisée de tous les chemins venus des mondes méditerranéens, arabes et perses à l’ouest, de l’Asie centrale turco-mongole et de la Chine au nord, de la péninsule indienne à l’est. Traversées fulgurantes ou installations pérennes, certains épisodes restent des marqueurs pertinents de l’Afghanistan contemporain. Ainsi, les Grecs d’Alexandre s’étaient installés durablement, remplacés au Ier siècle par les Kouchans venus du Xinjiang chinois, puis les Perses sassanides au IVe siècle, souvent bousculés par les incursions des Huns de Chine (les Hephthalites), jusque-là conquête de l’islam par les Arabes dès le VIIe siècle et des alternances assez rapides de dynasties locales, turco-persanes mais vassales du Califat de Bagdad [4]. Ah, le Califat ! Le retour du Califat est le rêve aujourd’hui de tous les militants salafistes ! Et pourtant, l’islam ne s’impose pas aussi rapidement qu’on le croit, la culture bouddhiste des Kouchans reste longtemps dominante dans les villes, et l’influence zoroastrienne de la Perse sassanide irrigue encore aujourd’hui les inconscients culturels du pays [5]. Les dévastatrices conquêtes mongoles de Gengis Khan au XIIIe siècle, puis de Tamerlan au XVe, secouent d’ailleurs le joug du Califat. Bagdad est une première fois rasée en 1258 par Hulagu Khan [6], une deuxième fois ravagée par Tamerlan en 1401… Étonnamment, ce moment de l’histoire entre aujourd’hui en résonance directe et tout à fait consciente avec l’Afghanistan contemporain. En effet, les Arabes d’Irak prenaient les cruelles invasions mongoles pour une punition de Dieu contre les sociétés musulmanes qui avaient désobéi à sa loi (charia). Or, six siècles plus tard, Abdallah Azzam [7], le théologien et conseiller personnel de ben Laden, établit un parallèle avec l’invasion soviétique en Afghanistan et fait explicitement référence au théologien arabe du XIVe siècle, Ibn Taymiyya, qui prêchait alors le retour à la pureté de l’islam des origines et inventa le djihad guerrier contre les sociétés impies… La première phase de notre analyse sur les consciences identitaires en Afghanistan contemporain s’arrête ici. Les grands courants de pensée que sont les religions du Bouddha, de Zoroastre et de Mohammad irriguent ce carrefour de l’Orient médiéval et les grandes conquêtes ont laissé derrière elles des peuples persans, turcs et mongols, qui s’identifient alors en référence aux compétitions entre lignages dynastiques, sans doute davantage qu’en référence à un concept bien défini de nation. Mais ils composent déjà la mosaïque régionale d’aujourd’hui, implantée au voisinage immédiat des autochtones pachtouns installés depuis deux millénaires au sud et à l’est, jusqu’aux rives de l’Indus.
La deuxième phase de constitution, à la fois des consciences nationales et de l’État, commence au début du XVIe siècle par la conquête du roi Babur, un prince turco-mongol, descendant de Gengis Khan par sa mère et de Tamerlan par son père. Contrairement à ses ancêtres, il soumet mais ne détruit pas. C’est même lui qui, après s’être imposé à Hérat et Kaboul, s’engage dans le nord-ouest de l’Inde où il fonde l’éblouissant Empire des Grands Moghols [8]. Dans le même temps, Shaybani Khan, un nouveau venu à la tête de tribus nomades qu’il réunit sous le nom de « Ouzbeks », établit sa horde au sud de la mer d’Aral (Boukhara, Khiva, Merv) et dans le nord de l’actuel Afghanistan (Hérat, Mazar) d’où il se fait refouler par les efforts conjugués des Safavides iraniens et de son cousin Babur. Définitivement confiné au nord d’une frontière naturelle, le fleuve Amou Darya [9], Shaybani devient le père historique de l’actuel Ouzbékistan, mais il a laissé derrière lui des familles ouzbèkes installées sur la rive afghane du fleuve. Ainsi se délimite un espace tampon entre trois Empires puissants mais désormais figés, contrairement aux siècles précédents, dans un équilibre des forces : les Safavides à l’ouest, les Shaybanides au nord et les Grands Moghols à l’est. Cette zone tampon est une bande étroite, selon une ligne Kaboul- Ghazni- Kandahar à l’ouest, et les rives de l’Indus à l’est, trop étroite pour les turbulentes tribus pachtounes, farouchement éprises d’indépendance mais prises en étau. Nous sommes à l’épicentre de tensions extrêmes, au cœur de ce que les Britanniques appelleront plus tard le « Grand Jeu ». Mais n’anticipons pas, nous ne sommes encore qu’à la veille d’une déflagration régionale qui donnera naissance au premier État pachtoun et à de fortes crispations identitaires, déterminantes des conflits du XIXe siècle et de l’imbroglio contemporain.
L’étincelle aux poudres est d’abord allumée par un Turc Qizilbash (« tête rouge »), Nadir Shah, qui depuis Kandahar ouvrit l’espace en soumettant d’abord la Perse, puis l’Inde du nord-ouest après la mise à sac de Delhi en 1739. Il faut attendre l’assassinat de Nadir en 1747, pour que s’impose l’autorité d’Ahmad Shah, un Pachtoun de la tribu Abdali. Ahmad Shah garde pour lui l’immense butin saisi à Delhi [10], et se fait appeler Dur-i-durrani (la perle des perles). Fort d’un tel rayonnement, il ne rencontre aucune difficulté à fédérer les autres tribus pachtounes et à lever une armée pour se tailler un Empire dans la foulée des conquêtes de Nadir. Dix années plus tard, l’Empire pachtoun englobe non seulement l’Afghanistan d’aujourd’hui, mais tout le bassin de l’Indus (aujourd’hui le Pakistan) jusque Delhi ! La descendance d’Ahmad Shah Durrani dirigera le nouvel État jusqu’en 1978 [11] et le coup d’État communiste de Taraki, encore un Pachtoun mais de la lignée Ghilzaï, concurrente des Durrani.
Ce nouvel Empire, fondé en 1747, prend donc le nom d’« Afghanistan » ; par son suffixe « -stan » [12], il se désigne comme le premier État de la région [13], au sens déjà moderne du terme. Or, « Afghan » est le terme qu’utilisent depuis toujours les persanophones pour désigner précisément les Pachtouns. « Afghanistan » est donc bien synonyme de « Pachtounistan » et recouvre à la fois le concept d’État, et une forte conscience d’identité nationale dont l’élément le plus structurant est le pakhtunwali, un code du comportement très strict et plus ancré dans les esprits que la charia. Les Pachtouns sont des guerriers mais ne sont pas nomades. Ils tiennent donc jalousement cette sorte de citadelle montagneuse, l’Hindu-Kush qui veut dire « tueuse d’Hindous », elle-même protégée au nord par l’Amou Darya, un fleuve impétueux, difficile à franchir, et ils contrôlent ainsi les velléités d’expansion des trois Empires qui les entourent. C’en est alors fini de ces siècles d’épopées fulgurantes, de ces mouvements rapides de hordes qui massacrent, s’installent et puis s’en vont, chassées par d’autres. Les grands espaces se morcellent et se figent, les peuples se sédentarisent et perdent une part de leurs ardeurs guerrières, laissant place à d’autres Empires venus de plus loin : l’Empire russe en Asie centrale et l’Empire britannique en Asie du sud. Les grands Empires coloniaux progressent plus lentement que les cavaliers mongols, leurs conquêtes sont avant tout d’ordre commercial, les routes de la soie pour les Russes, les échanges maritimes pour les Britanniques (la Compagnie maritime des Indes), mais ils structurent leur présence au fur et à mesure de leurs avancées. Ainsi les Britanniques favorisent-ils les petits États princiers à qui ils apportent une assistance administrative et dont ils garantissent la sécurité par une armée coloniale sans cesse plus puissante. Les colons « s’établissent », au sens étymologique, c’est-à-dire qu’ils créent des États coloniaux qui auront vocation, par « l’établissement » de frontières, à devenir des États-nations, un concept que ne connaissait pas l’Orient médiéval, mais qui sera lourd de conséquences.
En effet, au cours du XIXe siècle, les deux Empires coloniaux s’étendent au point de se menacer l’un l’autre. Les Russes sont maîtres de l’Asie centrale (Turkestan) après les prises de Tachkent en 1865, de Samarkand et Boukhara en 1868, de Khiva en 1873, de Ferghana en 1875. Au grand dam des Britanniques, ils traversent même l’Amou Darya pour s’emparer de Merv en 1884. Plus que jamais le jeune Afghanistan est un État tampon convoité, au centre du « Grand Jeu ». Les Britanniques tentent par deux fois de s’emparer de Kaboul, en 1841 et 1879, par deux fois ils se font massacrer : 16 000 morts sur la route de la retraite de 1842, entre Kaboul et Jalalabad ! Malgré trois guerres, jamais ils ne réussissent à conquérir l’Afghanistan mais ils l’amputent irrémédiablement en imposant une ligne de démarcation, la fameuse « ligne Mortimer Durand » (du nom du colonel anglais qui l’a tracée), signée en 1893, qui fait office de frontière sans en avoir jamais eu clairement le statut, malgré trois réécritures du traité, en 1905, 1919 et 1921. La ligne Durand fait basculer plus de la moitié de la population pachtoune du côté de l’Empire indien britannique. Le jeune État pachtoun ne s’en remettra jamais, mais la blessure est à l’origine d’un sentiment national très exacerbé et le plus souvent combattant.
À ce point de l’histoire des peuples et des États de la région, l’Afghanistan apparaît déjà dans sa configuration actuelle. Après la signature du traité de la ligne Durand, le roi Abdul Rahman compense l’amputation du pays à l’est, en consolidant son contrôle du nord, par l’implantation de colonies de peuplement pachtoun au milieu des Ouzbeks et des Tadjiks. Il est donc bien clair que l’État afghan s’identifie à la nation pachtoune. Mais qu’en est-il des autres ? À vrai dire, c’est surtout pendant ce XIXe siècle violent que naît le sentiment d’appartenir à une maison commune, que l’on soit afghan, c’est-à-dire pachtoun, ou qu’on ne le soit pas, et cette maison commune abrite toutes les populations prêtes à se battre pour n’être ni sous la botte russe, ni sous la botte britannique, ni sous domination de l’Iran chiite. Lorsque, après 1917, l’Empire colonial russe laisse la place à l’URSS, les Tadjikes persanophones et les Ouzbeks turcophones tourneront définitivement le dos à l’Ouzbékistan et au Tadjikistan soviétiques, à leurs yeux trop séculiers et athées. Mieux, les résistants au régime soviétique, les fameux basmatchis, finiront par traverser l’Amou Darya, « le Coran sur la tête » dit-on, plutôt que de rendre les armes, et grossiront ainsi les populations ouzbèkes et tadjikes d’Afghanistan. C’est même de cette dernière grande migration que date l’arrivée de quelque 200 000 Turkmènes venus de Merv et Ashgabad. En 1979, l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques ressoude encore les rangs de cette mosaïque des peuples. Si le nationalisme est le plus souvent pachtoun, le patriotisme afghan est partagé par tous. Il n’y a pas d’étude démographique fiable et récente, mais les chiffres admis sont les suivants [14] : Pachtouns 42 %, Tadjiks 27 %, Hazaras 9%, Ouzbeks 9 %, Aymaks 4 %, Turmènes 3 %, Baloutches 2 %, divers (Nouristanis, Pashaïs, Brahuis, etc.) 4 %. Chaque groupe a bel et bien conscience de ses signes de reconnaissance, par l’origine, la langue, les systèmes sociaux, une relative endogamie lorsque les critères de spécificité sont forts, comme les Hazaras du centre, chiites et descendants des premiers envahisseurs mongols. Cependant, ils se nomment plus souvent par le lieu où ils habitent que par le nom de l’ethnie. Panshjiri astom, « je suis du Panshjir » plutôt que « je suis tadjike ».Traditionnellement, seuls les Pachtouns se disent Afghans (qu’ils soient d’ailleurs citoyens d’Afghanistan ou qu’ils ne le soient pas). Et pourtant, on a remarqué pendant la guerre contre l’occupant soviétique et grâce à des solidarités de résistance et d’exil au Pakistan, que des non pachtouns commençaient volontiers à dire « je suis Afghan », mais parfois aussi simplement « je suis d’Afghanistan ». Le choix conscient d’appartenir à l’Afghanistan, quelle que soit l’origine ethnique, ne fait aucun doute, et même les Pachtouns dominants ne remettent pas cela en cause. Est-ce à dire que l’État afghan joue pleinement le rôle d’un État-nation du « vouloir-vivre ensemble ». Ce n’est pas si simple ; l’amputation de l’Afghanistan par la Ligne Durand a créé des déséquilibres qui ne sont pas seulement numériques ; il y a des lignes de fractures entre les Pachtouns eux-mêmes : la dynastie régnante a toujours été de la tribu Durrani (l’actuel président Hamid Karzaï est lui aussi un Durrani du lignage Popalzaï), alors que la tribu Ghilzaï a toujours été tenue à l’écart du pouvoir jusque 1978 ; elle a en revanche fourni les rangs communistes (1978-1992), puis du régime taliban (1996-2001), et une partie non négligeable de cette tribu Ghilzaï, du lignage Kokar, habite dans le nord du Baloutchistan pakistanais. Si l’on ajoute que, depuis la chute des Taliban, les Pachtouns ont perdu le poids qu’ils avaient autrefois dans l’appareil d’État, on comprend que les méfiances et rivalités ne facilitent pas l’intégration de la mosaïque non pachtoune au sein d’une même nation.
À ce point de l’analyse, nous ne pouvons plus progresser sans passer par le Pakistan, héritier lui aussi du traité de la ligne Durand. Outre les turbulentes zones tribales pachtounes, le Pakistan doit aussi gérer un paradoxe démographique grave : avec 12 ou 13 millions, la population pachtoune représente presque la moitié de l’Afghanistan, « pays des Pachtouns », alors que le Pakistan en compte aujourd’hui le double pour un poids beaucoup plus relatif de 15 % de sa population. Dans la logique des rapports entre États et nations, le centre de gravité de la nation pachtoune n’est pas du bon côté. À cela s’ajoutent les groupes terroristes wahhabites et salafistes, exogènes mais installés dans les zones tribales, qui véhiculent une idéologie très particulière autour du concept de nation.
Pakistan
Nous avons souligné le morcellement des grands espaces que parcouraient les conquérants de l’Orient médiéval. Pour achever ce morcellement, Staline décida en 1924 de diviser le Turkestan en cinq Républiques autonomes qui deviendront les cinq Républiques indépendantes d’Asie centrale, à la chute de l’URSS en 1991. Chacune porte le nom de la nation qui la fonde : Kazakh-stan, Kirghiz-i-stan, Ouzbek-i-stan, Turkmen-i-stan, Tadjik-i-stan [15]. Elles s’ajoutent à l’Afghan-i-stan déjà constitué. Au moment de sa création en 1947, le Pak-i-stan fait donc exception puisque pak signifie « pur » et ne correspond à aucune nation distincte. En réalité, ce qu’on appelle la « théorie des deux nations », l’une hindoue, l’autre musulmane et « pure », est le seul fondement du Pakistan et sa seule raison officielle telle qu’elle apparaît encore dans tous les manuels scolaires du pays. Au moment où les Britanniques abandonnent leur Empire des Indes, les musulmans craignent d’être submergés par les hindous majoritaires. La partition de l’Empire s’impose alors et le Pakistan est conçu comme une « maison commune » pour tous les musulmans de l’Asie du Sud. Évidemment, les mouvements migratoires qui suivent l’indépendance, dans les deux sens, pour rejoindre ou pour fuir la « maison commune », sont très meurtriers. Mais il faut surtout souligner que seul le facteur religieux a été retenu pour définir le concept d’une nouvelle nation et d’un État-nation. Les hindous assurent d’ailleurs la réciproque puisque le Bharatiya Janata Party (BJP), un parti politique majeur en Inde (au pouvoir de 1998 à 2004), se définit lui-même comme un parti « nationaliste hindou ». Mais, différence notoire, la religion hindoue est à peu près contenue dans la péninsule indienne, ce qui n’est pas le cas de la religion musulmane qui s’étend de l’Indonésie au Maghreb. Ainsi, Maud-ud-Din, alors chef du parti islamique Jamaat-i-Islami, est réticent à cette création du Pakistan, au prétexte qu’on ne peut libérer la « nation musulmane » pour l’enfermer aussitôt dans les frontières d’un État. Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan, lui-même très séculier, entend bien éviter le piège et déclare dans son discours inaugural de la première Assemblée constituante, en août 1947 : « Avec le temps, les hindous cesseront d’être hindous et les musulmans d’être musulmans, non pas au sens religieux car il s’agit de la croyance personnelle de chaque individu, mais au sens politique, en tant que citoyens de l’État » [16]. Rêve inachevé puisqu’il meurt un an plus tard : Ali Jinnah avait mal mesuré à quel point l’islam est fondamentalement politique et ne peut pas rester confiné dans la sphère du privé. Malgré toutes les contorsions possibles de l’esprit, les héritiers de Jinnah, dont beaucoup sont alors des modernistes, ne réussissent pas à marier « nation islamique » et « État laïc ». En effet, les clercs religieux qui siègent en nombre à l’Assemblée constituante, se disent absolument démocrates mais affirment aussi qu’une démocratie musulmane n’a pas besoin d’Assemblée législative puisque l’islam dispose déjà d’un corpus de lois, la charia, et qu’une Assemblée où siégeraient seulement des Oulémas (docteurs de la Loi), représentants naturels de la nation, suffirait à réglementer démocratiquement les champs d’application de la charia. Dans ces conditions scolastiques acrobatiques, le Pakistan mettra neuf ans à rédiger et adopter une Constitution, un compromis bizarre où le mot « charia » n’apparaît pas, mais qui contient en préambule une « Déclaration d’objectifs » qui en garantit le caractère islamique et affirme la « souveraineté de Allah » (sic) !
Cette théorie des nations religieuses comme fondement d’un État-nation apporte donc beaucoup de confusions, d’autant que le Pakistan est composé de plusieurs provinces à forte conscience identitaire. S’il fallait n’en citer qu’une, le cas du Baloutchistan est le plus emblématique du télescopage de deux définitions incompatibles de la nation. En effet, « Baloutch-i-stan » signifie bien qu’une nation baloutche s’était déjà arrogé le statut de « -stan », ce que confirme l’histoire puisque le Baloutchistan était un État souverain depuis 1666 ! Cette souveraineté était même garantie par les Britanniques (traité de Sandeman, 1876) en contrepartie du droit pour ces derniers d’installer des cantonnements militaires sur le flanc sud de l’Afghanistan. Ce traité était toujours en vigueur au moment de la partition [17]. Ainsi, le Baloutchistan reste aujourd’hui la province la plus secouée par le nationalisme militant. Les médias en parlent moins que des zones pachtounes car les insurrections permanentes ne sont pas islamistes, de type taliban ou Al-Qaïda. Bien au contraire, les partis nationalistes balouches [18] affichent tous leur obédience marxiste et ne sont donc pas perçus comme une menace mondiale. En revanche, un train pouvant en cacher un autre, les risques de déstabilisation de l’État viennent au moins autant du Baloutchistan que des zones pachtounes, mais auraient les mêmes répercussions régionales, la nation baloutche s’étendant largement sur les territoires de l’Iran (le Séistan) et du Sud afghan.
Le concept d’une nation musulmane est donc inopérant au regard des fortes identités nationales, revendiquées et regroupées au sein du ponam [19] mais il explique la totale incapacité de l’État à gérer harmonieusement les provinces. S’il y avait eu une nation musulmane viable au Pakistan, elle n’aurait pu se développer qu’autour et à partir du bassin moyen et inférieur de l’Indus, là où s’interpénètrent les cultures pendjabies, seraïkies, baloutches, sindhies et pachtounes, dans un islam syncrétique unique au monde, où survivent des influences brahmaniques de l’Inde et zoroastriennes d’Iran, baignées dans des pratiques musulmanes soufies, plus mystiques et fraternelles que dogmatiques et combattantes [20]. Mais les confréries soufies locales n’ont pas de goût particulier pour la politique [21], c’est donc l’islam dogmatique déobandi qui s’est imposé au Pakistan, dès le départ et sous l’influence de Maud-ud-Din, comme seule force structurante de l’islam politique (Jamaat-i-Islami et Jamaat-i-Ulema-i-Islami pour l’essentiel). Au lieu de laisser respirer naturellement l’islam traditionnellement tolérant du Pakistan, l’islam politique s’est surtout efforcé de créer et structurer des causes militantes islamiques, en espérant cristalliser ainsi une identité nationale pakistanaise autour d’épopées communes. La première de ces causes combattantes a, bien sûr, été focalisée dès 1947 sur le Cachemire qui n’aurait pas dû, selon le Pakistan et la théorie des deux nations, rester dans le giron de l’Inde. Le Pakistan met beaucoup d’argent dans son armée, pour être capable d’affronter l’Inde, il engage des conflits et perd trois guerres, mais il soutient aussi et entretient des armées de l’ombre qui conduisent la guerre sainte, le djihad, dont le but est de libérer la « nation musulmane » retenue sous le joug de la « nation hindoue », ennemie par nature donc honnie. Le second djihad est mené aux côtés des partis islamiques de la résistance afghane contre l’invasion soviétique de 1979, et offre le double avantage d’être mobilisateur de la nation et d’attirer le soutien, donc les aides économiques, de l’Occident et des États musulmans, au premier rang desquels l’Arabie Saoudite dont le parrainage est précieux pour faire éclore la fierté nationale d’être le deuxième pays musulman le plus peuplé du monde. Puis, cerise sur le gâteau en 1998, la première bombe atomique islamique fait lever la clameur de « Pakistan zindabad ! » (vive le Pakistan !), un peu partout sur le territoire. Mais, c’est sans doute là le dernier engouement collectif, très passager et insuffisant pour dire qu’il existe aujourd’hui une nation musulmane pakistanaise, ou même l’embryon cohérent d’une entité unifiée.
L’État et les partis de l’islam politique ont joué ensemble une même partition mais ils ont surtout joué avec le feu. L’aventure des Taliban, venus du Pakistan en 1994 pour s’imposer en Afghanistan, a mal tourné. Leur défaite, après le 11 septembre 2001, a eu un effet boomerang dans le nord du Baloutchistan et dans les zones tribales pachtounes de la frontière où ils se sont repliés et réorganisés avant de reprendre les offensives en Afghanistan. Pire encore, dans l’agence tribale du Waziristan, les Taliban pakistanais les plus extrémistes de la tribu Mehsud ont créé le Tehrik-i-Taliban-Pakistan (TTP), le plus puissant et le plus efficace réseau terroriste régional. L’acte officiel de naissance du TTP date de décembre 2007, mais c’est en réalité depuis 2005 qu’il attaque sans relâche toutes les structures de l’État pakistanais, partout dans le pays, en représailles du ralliement du président Pervez Musharraf à l’Amérique de Georges W. Bush et l’engagement de l’armée pakistanaise dans les zones tribales en avril 2004. Le TTP n’impose pas seulement sa loi de fer et de feu dans toute la province pachtoune du nord-ouest, il n’attaque pas seulement l’armée, la police et les convois de l’otan, mais il s’en prend aussi aux magistrats, aux élites politiques [22] et à tous les lieux de culte qui ne sont pas dans la droite ligne de l’islamisme sunnite le plus puritain, c’est-à-dire les mosquées et mausolées chiites et soufies partout dans le pays, de Peshawar à Lahore, d’Islamabad à Karachi, de Quetta à Multan. Pour un simple aperçu de l’efficacité mortifère du TTP, notons qu’entre octobre 2009 et octobre 2010, 88 attentats suicides ont fait 1 790 morts [23] dans la population civile (soit 20 morts par attentat et 150 par mois en moyenne). Ce chiffre ne tient évidemment pas compte des combats quotidiens entre insurgés et armée, et des bombardements aériens de zones sensibles. En tout, ce qu’il faut bien appeler une guerre a fait près de 12 000 morts entre août 2008 et juillet2009 [24].
La population du Pakistan n’en peut plus ! L’État ne contrôle plus les forces du djihad qu’il avait mises à l’œuvre avec l’aide de l’armée et des partis de l’islam politique. S’il y avait eu une toute petite chance de réussir à faire naître un sentiment national islamique autour de quelques causes communes, c’est raté, d’autant qu’une crise structurelle de l’économie et les inondations sans précédent de cette année, creusent encore la profondeur du désespoir populaire. De cet échec de l’islam comme ferment d’une nation nouvelle sous le drapeau du même État, découle ipso facto le retour à des identifications nationales séculières et très anciennes, voire à des luttes nationalistes. Mises à part les causes sindhies, seraïkis et baloutches que nous avons déjà citées, cela nous ramène, pour fermer la boucle de cette analyse régionale, au nationalisme pachtoun qui est le véritable enjeu entre Afghanistan et Pakistan, soit pour une sortie de crise, soit au contraire pour une balkanisation dont on n’ose imaginer les conséquences !
Af-pak ou le laboratoire d’Al-Qaïda pour une nation islamique sans État
La communauté internationale a souvent reproché au Pakistan de trop mettre son nez dans les affaires afghanes, par souci de « profondeur stratégique ». Beaucoup d’âneries ont été dites sur cette profondeur stratégique, la plus courante étant que l’armée pakistanaise aurait besoin d’un repli en Afghanistan en cas d’attaque de l’Inde ! Qui connaît la topographie sait que c’est absurde. A-t-on jamais imaginé l’armée française se repliant de l’autre côté des Pyrénées pour contrer une offensive en Champagne ? En réalité, la profondeur stratégique est une obsession géopolitique car l’Afghanistan n’a jamais reconnu la ligne Durand comme frontière internationale. Or, le nationalisme pachtoun séculier, soutenu par l’Inde et l’URSS, a été virulent dans les années 1950-1970. Côté pakistanais, les partis nationalistes séculiers, Awami National Party (actuellement au pouvoir à Peshawar) et le Pakhtunkhwa Milli Awami Party, affichent leurs sympathies marxistes et soutiennent les insurrections. En 1948, le drapeau du Pachtounistan indépendant, soutenu aussi par le roi afghan Zaher Shah, flotte sur le Waziristan et la vallée de Tirah. Doté d’un chef, le Faqir de Epi, et d’un Parlement, l’État rebelle tient tête à la jeune armée pakistanaise pendant une vingtaine de mois ! Quant aux élites pachtounes nationalistes afghanes, elles sont éduquées en URSS, et appuient le président afghan Daoud (1973-1978) lorsqu’il revendique toutes les zones pachtounes du Pakistan comme partie intégrante de l’Afghanistan ; il fait même éditer des cartes repoussant la frontière jusqu’à l’Indus… Déjà menacé à l’est par l’éternelle dispute du Cachemire, le Pakistan redoute cette autre menace territoriale à l’ouest et met à profit son aide à la résistance des moudjahiddins contre l’occupation soviétique des années 1980, pour préparer l’installation à Kaboul d’un régime ami, islamique mais à dominante pachtoune, dont il garantirait lui-même la pérennité, afin d’étouffer toute nouvelle velléité nationaliste d’expansion vers un « Grand Pachtounistan » [25]. Ainsi, en 1992, après la chute du régime communiste afghan, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif se déplace en personne à Kaboul pour accueillir le nouveau président afghan Mujadiddi, arrivé lui-même de Peshawar ! Mais l’Afghanistan sombre très vite dans une guerre civile incontrôlable. Deux années plus tard, et bien qu’ils fussent trop puritains aux yeux d’une certaine élite civile pakistanaise, Islamabad considère que les Taliban font l’affaire parce qu’ils sont musulmans, pachtouns, éventuellement nationalistes, mais sous contrôle. On connaît la suite, l’attentat du 11 septembre, la chute du régime taliban, l’intervention des forces de l’otan, et le repli des Taliban sur les zones tribales pakistanaises. Certes le Pakistan, allié des forces internationales contre le terrorisme, combat les militants exogènes d’Al-Qaïda installés dans les zones frontières, mais il protège aussi les Taliban indigènes, en espérant qu’ils puissent encore servir un jour pour regagner cette profondeur stratégique provisoirement perdue. Mais, et le TTP en est la preuve, le Pakistan a tout simplement perdu le contrôle de cette trop subtile stratégie. La stabilité régionale des entités nationales et des États pourrait bien en souffrir gravement.
Le TTP est un agrégat des forces talibanes locales et des militants extrémistes d’Al-Qaïda (Arabes, Tchétchènes, Ouïghours). Rappelons que Al-Qaïda, étymologiquement la « base » organisationnelle du djihad international, a été implanté par Oussama ben Laden dès 1984, précisément à Jaji, une bourgade afghane de la province du Paktya, à quelques kilomètres seulement de la frontière, la très contestée ligne Durand ! Ce n’est évidemment pas un hasard ! En effet, Al-Qaïda, irrigué par une théologie de type wahhabite et salafiste, érige l’Oumma (communauté des croyants) au rang d’une nation indivisible et conforme aux stricts « hadith », les « dires » du prophète. Ainsi, le but d’Al-Qaïda, partout où il s’installe, est d’abord de casser les États-nations, héritages coloniaux, qui enferment et divisent l’Oumma, en préalable à l’ouverture d’un grand territoire national musulman, le fameux « Grand Califat » qui serait expurgé de tous les hérétiques soufis, chiites, ahmadyas ou autres (d’où les nombreux attentats suicides dans les mosquées étiquetées « impies » du Pakistan). Par un paradoxe qui n’est alors qu’apparent, la stratégie du jihad global consiste à attiser les nationalismes locaux pour mieux y semer l’idéologie rédemptrice de la guerre sainte et la diriger ensuite vers la destruction des structures et du pouvoir central des États. C’est exactement ce qu’a réussi à faire ben Laden dans cette région frontalière fragile et toujours prête à se soulever. De surcroît, le TTP a aujourd’hui récupéré et fédéré à son avantage tous les groupes terroristes qui s’étaient constitués dans le Pendjab au cours des années 1980 et 1990, avec la bénédiction de l’État et le soutien actif de l’armée et des partis de l’islam politique, pour faire le coup de feu au Cachemire. Les liens organiques entre l’armée et le très wahhabite Lashkar-e-Taeba alias Jamaad-ud Dawa de Lahore sont bien connus, de même que la filiation entre le Jamaat-i-Ulema-i-Islami et le Harakat-ul-Mudjahiddin, le Sepah-i-Saheba, le Jaish-i-Mohammad et le Lashkar-i-Jhangvi d’une part, et entre le Jamaat-i-Islami et le Hizb-ul-Mujaddin d’autre part.
Le Pakistan est ainsi pris dans un piège étonnant. Fondé sur la théorie du primat religieux comme élément constitutif d’une nation, il se trouve débordé sur son propre terrain par un islamisme radical venu d’ailleurs et dont les fondateurs du pays n’avaient certainement pas imaginé qu’il pousserait le concept à ce point d’incandescence.
Conclusion
L’Afghanistan, État pachtoun dans l’esprit de son fondateur en 1747, avait bien vocation à être un État-nation composite, les nations non pachtounes ayant clairement exprimé leur « vouloir-vivre ensemble » par deux siècles de combats aux côtés des tribus, pour sécuriser un territoire commun et indépendant des Empires voisins. Mais nous avons vu aussi pourquoi l’Afghanistan, situé au centre du partage des grands Empires, n’a jamais trouvé la respiration nécessaire pour structurer un État moderne et apaisé. Les guerres coloniales se sont soldées par une amputation de territoire et la division de la nation fondatrice du pays, et le Great Game a encore connu deux dramatiques rebondissements, l’un en 1979 par l’invasion soviétique, l’autre depuis 2001… Il ne reste plus grand-chose des espoirs qu’avait fait naître le long règne sans guerre (1933-1973) du roi Zaher Shah et la promulgation de la Constitution de 1964.
L’État est aujourd’hui un État failli tant les défis semblent insurmontables. Les Britanniques, qui ont décidément le sens de la formule, ont aussi qualifié l’Afghanistan de « Cimetière des Empires ». Des Empires coloniaux certes, mais si les acteurs d’aujourd’hui n’y prennent garde, l’Afghanistan pourrait être le cimetière de lui-même. Ce pourrait être d’ailleurs le résultat, si elle était mise en œuvre, d’une récente et stupéfiante idée de Robert Blackwill, un proche de G. W. Bush, ex-ambassadeur en Inde (2001-2003), qui ne propose rien moins que la partition de l’Afghanistan en deux États distincts, le nord et l’ouest non pachtoun d’un côté, le sud et l’est pachtoun de l’autre. Passons ici sur le détail d’arguments qui font froid dans le dos, selon lesquels les forces de l’OTAN, concentrées dans le nouvel État du nord, pourraient pilonner massivement et terroriser l’État pachtoun du sud, « cibler non seulement les terroristes mais tous les fonctionnaires civils talibans comme les gouverneurs, les maires, les juges, les collecteurs d’impôts, de sorte que chaque matin ils ne puissent savoir s’ils survivront le soir (sic) » [26] ! Tout ce qui est excessif est insignifiant, sauf que l’idée fait son chemin dans certains think-tanks et mérite que les conséquences en soient analysées. En deux mots ici, outre que les nations du nord ne veulent certainement pas de cette partition [27], mais que certains chefs de guerre pourraient cependant y trouver un avantage à court terme [28], disons que cette stratégie est exactement l’erreur que les idéologues d’Al-Qaïda attendent de l’Occident, puisqu’elle conduirait inéluctablement à la reconquête d’un « Grand Pachtounistan », – comme en 1747 et à peu près pour les mêmes raisons – donc à l’éclatement des deux États voisins. Car le Pakistan est lui aussi un État failli ; il y a davantage aujourd’hui de forces centrifuges des nations que de ferments d’union, et le Pakistan partage avec l’Afghanistan la récurrente question pachtoune, qui est aussi la principale source d’instabilité.
Dans cette région du monde, les nations ne sont pas des entités dépassées, elles sont des entités crispées à l’extrême, entre elles et parfois en elles-mêmes, que les deux États voisins ne parviennent plus à gérer. Or, chacun sait que revenir sur les frontières coloniales serait aussi mortifère que de les avoir fabriquées. En créer de nouvelles aussi ! Les nations de la région sont plus soucieuses et jalouses de leurs espaces à préserver que des États qui les gouvernent. En même temps, ce serait chimère de croire avec les Salafistes que l’émergence d’une nation musulmane pourrait transcender les clivages de l’histoire sur les décombres des États post-coloniaux. Aider les deux États de la région à repenser leur relation avec les nations reste actuellement la seule approche possible pour éviter une balkanisation que le poids démographique de la région rendrait parfaitement ingérable. Et pour faire face à l’urgence, pour calmer les irrédentismes nationalistes locaux et assécher le terreau fertile d’Al-Qaïda aux frontières, il devient urgent qu’Afghanistan et Pakistan entrent de concert en négociation avec les tribus pour définir un nouveau modus operandi de la frontière [29]. La cogestion d’un espace national non fracturé, respiration retrouvée d’une nation cohérente et apaisée. Mais surtout pas la guerre par de nouveaux morcellements !
Copyright Choiseul 2011
Plus
Joao Medeiros(dir.), Le mondial des nations. 30 chercheurs enquêtent sur l’identité nationale, Paris, éd. Choiseul en partenariat avec RFI , 2011, 575 p.
Présentation par l’éditeur
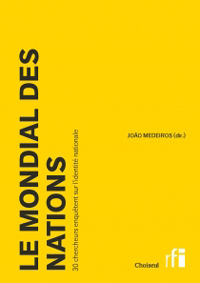
Cet ouvrage est né d’un pari scientifique ambitieux, et même un peu fou : visiter un maximum de nations sur les cinq continents et cartographier l’identité nationale de chacune d’entre elles.
Chercheurs, diplomates et journalistes, français et étrangers, ont ainsi interrogé le sentiment afghan, brésilien, marocain, israélien, chinois, yéménite, français..., pour nous offrir un voyage insolite, passionnant et troublant.
Le Mondial des nations se lit comme un grand livre de contes humains, définitivement originaux.
Joao Medeiros est docteur en science politique de l’IEP de Rennes, professeur à l’Institut des Hautes études de Journalisme (HEJ) à Montpellier.
Voir sur le site des éditions Choiseul Voir
Pour ne rien rater de nos nouvelles publications, abonnez-vous à la Lettre du Diploweb !
[1] . « Qu’est-ce qu’une nation ? », conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne.
[2] . Fondé par Attaullah Mengal (Baluchistan National Party) en 1998, le PONAM regroupe 26 partis nationalistes, pachtouns, baloutches, sindhis, seraïkis, et gagne en popularité depuis les opérations de répressions militaires au Baloutchistan et dans la ceinture tribale pachtoune.
[3] . La racine « Sthit- » en Sanskrit (« debout », « bien implanté ») est à l’origine de « statos » en grec, « sto » en latin, et de tous ses dérivés en langues indo-européennes, comme « state », « die Stadt », « stable », « étable », « État » etc., mais aussi le suffixe « -stan » de Afghanistan, Ouzbékistan, Pakistan etc., en langues indiennes et iraniennes.
[4] . Tahirides, Saffarides et Samanides se succèdent entre 820 et 950. Puis la dynastie Ghaznavide, riche de ses savants, al Biruni et Ferdousi, laisse une trace durable (ville de Ghazni au sud de Kaboul) jusque Gengis Khan au début du XIIIe siècle. Entre-temps, les Turcs seldjoukides se sont rendus maîtres du nord-ouest (Balkh, Herat) de cette aire géographique qu’on n’appelle pas encore Afghanistan.
[5] . Le calendrier « jalali », toujours en usage en Afghanistan, est d’origine zoroastrienne.
[6] . Petit-fils de Gengis Khan.
[7] . Mort dans un attentat à Peshawar en novembre 1989.
[8] . Babur est le premier conquérant turco-mongol à écrire son épopée. Le fameux Babur Nama a été traduit du turc tchaghataï en français, par J.-L. Bacqué-Grammont, Le Livre de Babur, Mémoires du premier Grand Mogol des Indes, 1494-1529, Imprimerie Nationale, 1985.
[9] . L’Amou Darya était appelé Oxus par les Grecs.
[10] . Dans le butin du sac de Delhi, il y a le fameux Koh-i Nor (la montagne de lumière), le plus gros diamant du monde, qui orne aujourd’hui encore la couronne d’Angleterre !
[11] . Dynastie royale jusque Zaher Shah déposé en 1973, puis République présidée par Daoud, neveu et gendre de Zaher.
[12] . Cf. note bas de page n° 3.
[13] . À l’exception du Baloutchistan (1666) que nous évoquerons plus loin.
[14] . « Country Profile : Afghanistan », Library of Congress Country Studies on Afghanistan, août 2008, http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Afghanistan.pdf ; et « Afghanistan - People : Ethnic groups », Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/7798/Afghanistan
[15] . En réalité, ce découpage qui satisfait au concept rigoureux de l’État-nation, est extravagant comme le montrent par exemple les nombreuses enclaves de l’Ouzbékistan en Tadjikistan et vice versa, ou les capitales adossées à la frontière de la République voisine. Un découpage machiavélique imaginé par le Commissaire aux nationalités (Staline) pour garantir un absolu contrôle par le pouvoir central.
[16] . Citée dans L. Binder, Religion and Politics in Pakistan, Berkeley, University of California Press, 1961, p. 100, cette phrase d’un discours officiel a tellement choqué les religieux qu’elle a depuis disparu de la plupart des textes d’histoire, remplacée par une autre citation moins complexe : « Vous êtes libres, libres d’aller à vos temples, libres d’aller à vos mosquées et n’importe où au sein du Pakistan ».
[17] . Le traité de Sandeman ressemble beaucoup à un autre traité signé entre le Raj britannique et le Népal, au terme duquel le Népal a pu garder son statut d’État indépendant après la partition.
[18] . Partis autonomistes : Baluchistan Student Organisation (BSO) est la matrice de tous les autres : Balochistan National Party, Jamhoori Watan Party (parti démocratique de la patrie), National Party, Baluchistan Haq Tawar (« la sage parole du B. »). Ces partis ont signé une alliance en 2002 sous le nom de Baloch Nationalist Quadrennial Alliance. Organisations séparatistes : Baluchistan People’s Liberation Front, Baluchistan Liberation Army, Baloch Liberation United Front, Baluchistan Democratic Party et son bras armé le Baluchistan Democratic Army.
[19] . Voir ci-dessus dans l’introduction, et note bas de page n° 2.
[20] . Lire l’excellente analyse de P. Lafrance, Et pourtant le Pakistan existe, in C. Jaffrelot (dir.), Pakistan, carrefour des tensions régionales, Complexe, Bruxelles, 1999.
[21] . Cependant, en réaction au radicalisme militant et au terrorisme, les soufis se sont récemment organisés. Cf. la thèse de doctorat de A. Philippon, La politique du Pir, du Soufisme au soufislamisme. Recomposition, modernisation et mobilisation des confréries au Pakistan, IEP Aix en Provence, 2009.
[22] . L’assassinat de Benazir Bhutto, en décembre 2007, a été revendiqué par le TTP.
[23] . Source, South Asia Terrorism Portal, http://www.satp.org
[24] . Ibid.
[25] . Terme d’autant plus dérangeant qu’il est synonyme d’Afghanistan.
[26] . Cf. le site américain Politico, 7 juillet 2010, Robert D. Blackwill, « A de facto partition for Afghanistan », http://dyn.politico.com/printstory.cfm?uuid=AACEE164-18FE-70B2-A8E30566E50DFB3A
[27] . A. Rashid, « Devide Afghanistan at your peril », Financial Times, 3 août 2010.
[28] . F. Bobin, « La partition de l’Afghanistan, une fausse bonne idée », Le Monde, 2 novembre 2010.
[29] . G. Lefeuvre, « La frontière afghano-pakistanaise, source de guerre, clef de la paix », Le Monde Diplomatique, octobre 2010.
Direction

Directeur, P. Verluise
Conseil scientifique
Mentoring et coaching géopolitique
Présenter le Diploweb.com
Charte du site
Auteurs
Proposer un article
Retrouvez la chaîne Diploweb sur :











