Géopolitique de la Lituanie. Le voyage du Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Pierre Lellouche, en Lituanie est l’occasion d’en savoir un peu plus sur ce pays membre de l’Union européenne depuis 2004.
Dans le cadre de ses synergies géopolitiques, le diploweb.com est heureux de vous présenter en exclusivité sur Internet un chapitre du livre d’Antoine Jacob, Les pays baltes. Un voyage découverte, publié aux éditions Lignes de repères en 2009. Il aborde ici la question énergétique à travers l’arrêt de la centrale nucléaire lituanienne d’Ignalina et la construction du gazoduc Nord Stream entre l’Allemagne et la Russie.
Les dilemmes d’Ignalina et de Nord Stream
L’AMBIANCE n’était pas à la fête lorsque le personnel de la centrale nucléaire d’Ignalina célébra le vingtième anniversaire de cette installation controversée, le 23 janvier 2004, dans l’est de la Lituanie. Pourtant, la fanfare s’évertuait à égayer la foule. Le président de la République et le premier ministre étaient venus expressément de Vilnius, à cent trente kilomètres de là. Sur la tribune, les orateurs se succédèrent devant une bonne partie des quelque quatre mille employés, réunis pour l’occasion dans la grande salle destinée à ce genre de réjouissances officielles. Flonflons, dignitaires, discours… Pour un peu, on se serait cru revenu vingt ans en arrière, pour l’inauguration du premier des deux réacteurs de cette centrale civile gigantesque, qui faisait alors la fierté de la république balte soviétique et devait fournir en électricité tout le flanc occidental de l’URSS. Le premier secrétaire du Parti communiste lituanien de l’époque n’était autre qu’Algirdas Brazauskas, chef du gouvernement en 2004. Le cheveu blanchi, la silhouette épaissie par les années, à quoi pouvait-il penser, ce politicien bonhomme à la longévité remarquable, en soufflant les vingt bougies de ce qui fut l’une de ses grandes réalisations ?
Car voilà que la centrale devait fermer. Le premier réacteur avant le 31 décembre 2004 à minuit – ce fut fait trois heures et cinquante-huit minutes avant le délai imparti. Le second d’ici la fin de 2009 au plus tard. Non que ces unités aient donné un quelconque signe de faiblesse. La centrale, la seule des pays baltes, fonctionne a priori sans problème particulier. Ni mieux ni plus mal qu’une de ses homologues suédoises, par exemple, qui tournent de l’autre côté de la mer Baltique. Mais il en est ainsi. Ignalina est vouée à une mort anticipée pour satisfaire aux conditions posées par l’Union européenne à l’entrée de la Lituanie en son sein. Il est vrai que la centrale a une tare et elle est de taille : ses réacteurs sont du même type que ceux de Tchernobyl. Et cela, les Quinze ne pouvaient l’accepter au moment de négocier avec Vilnius les modalités de son adhésion.
Tchernobyl. La seule évocation du nom fait frissonner. Tout le monde en âge de s’en souvenir garde à l’esprit les images filmées d’hélicoptère de cette installation éventrée par une explosion, les « volontaires » envoyés à une mort certaine pour colmater ce qui pouvait l’être, les populations de cette région d’Ukraine évacuées avec retard et les nuages radioactifs qui, selon le gouvernement français de l’époque, s’arrêtèrent au-dessus de nos frontières…Régulièrement, un reportage télévisé tente de tirer un nouveau bilan sanitaire de ce qui reste, à ce jour, le plus grave accident nucléaire jamais survenu sur la planète. Des milliers de morts, des dégâts à long terme causés par la contamination, malformations congénitales, cancers de la thyroïde chez les enfants…
Tout cela, les Lituaniens en sont bien conscients. Tchernobyl se trouve à moins de cinq cents kilomètres au sud-est de Vilnius. Ce fut avec ces scènes d’angoisse en mémoire que des centaines de personnes bravèrent les autorités communistes pour manifester, en 1988, contre le projet d’agrandissement d’Ignalina. En effet, de la place pour deux réacteurs supplémentaires avait été prévue au côté des deux mastodontes en fonctionnement, dont les cheminées blanches striées de rouge s’élancent au-dessus d’une clairière ouverte à perte de vue, au milieu d’une région forestière.
Aux craintes des premières années succédèrent toutefois des sentiments ambivalents. Certes le nucléaire a un potentiel nocif incommensurable. Mais tant qu’il est sous contrôle, il constitue une source d’électricité presqu’intarissable et bon marché. Or les Lituaniens se souviennent encore de l’arrêt des livraisons de carburant par Moscou pour ramener à la raison la petite république balte tentée par la sécession. Beaucoup plus récemment, à l’été 2006, le Kremlin a de nouveau fait fermer le robinet. Depuis, l’oléoduc Droujba (« amitié » en russe) n’approvisionne plus la raffinerie lituanienne Mazeikiu Nafta, la seule des pays baltes. Officiellement à cause d’une fuite, côté russe, sur cette conduite en fonctionnement depuis les années 1970. Pour Vilnius, il s’agit à n’en pas douter d’une mesure de représailles prise après la décision du gouvernement de vendre ladite raffinerie à un groupe polonais (PKN Orlen) plutôt qu’à un russe. Pour compenser, Mazeikiu Nafta importe désormais du brut par tanker via la mer Baltique.
L’indépendance énergétique est une préoccupation majeure pour un pays qui, comme ses cousins baltes, est à la merci totale de la Russie pour son approvisionnement en gaz et dépend grandement d’elle pour le pétrole. Fermer Ignalina, c’est priver la Lituanie d’un de ses principaux atouts industriels et d’une source qui représente plus de 70 % de sa production d’énergie, dont une bonne moitié – avant l’arrêt du premier réacteur – était vendue à l’étranger (dans l’ordre décroissant, la Biélorussie, l’enclave russe de Kaliningrad, la Lettonie, la Pologne et l’Estonie). Avec la France, ce pays est l’un des plus dépendants du nucléaire en matière de consommation d’électricité. C’est ce qui explique sans doute pourquoi une majorité de sa population se déclare favorable à ce type d’énergie.
Viktor Nikolaïevitch Chevaldine a vécu de l’intérieur une bonne partie de l’épopée du nucléaire civil soviétique. Il débuta à la centrale de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) en 1971, soit dix-sept ans après que le pays a produit pour la première fois de l’électricité grâce à l’atome. En 1982, il fut transféré à Ignalina pour participer à la dernière phase de la construction de ce qui devait être le plus puissant réacteur au monde, d’une capacité nominale de mille cinq cents mégawatts (MW). Séparée de la république soviétique de Biélorussie par le grand lac de Drukchiaï, la commune lituanienne avait été choisie par Moscou pour des raisons géographiques et géologiques. Les Baltes n’ayant aucune connaissance particulière dans ce type d’énergie, la main-d’œuvre fut importée des quatre coins de l’empire soviétique. On bâtit une ville ex nihilo pour l’héberger, Visaginas, à six kilomètres de là. Le deuxième réacteur, lui aussi de mille cinq cents MW, fut inauguré comme prévu en 1987, malgré Tchernobyl.
« Évidemment, tout le monde ici pensait à l’accident. Nous avons essayé de comprendre ce qui s’était passé en Ukraine », raconte Viktor Chevaldine, directeur d’Ignalina depuis novembre 1991. Selon lui, une expérience en cours sur le réacteur numéro quatre de Tchernobyl, celui où se produisit l’explosion, eut un effet catastrophique. « C’était de la folie de la part des responsables de l’avoir autorisée. » À en croire ce responsable, « si elle n’avait pas eu lieu, Tchernobyl fonctionnerait encore aujourd’hui… et personne n’aurait voulu fermer Ignalina ! » Il y a une bonne dose d’amertume dans les propos de ce quinquagénaire d’origine russe. Pourtant, les réacteurs des deux centrales ne sont-ils pas du même type [1], conçus sans enceinte de confinement les couvrant entièrement pour protéger l’environnement en cas d’accident ? « La construction est très similaire, c’est vrai. Nous ne pouvons rien y faire aujourd’hui. C’est notre seul point faible. Mais nos systèmes opérationnels, de sécurité, de protection et de localisation d’incidents, sont plus modernes que ceux de Tchernobyl, qui n’étaient pas équipés de façon aussi complète. Toutes ces mesures compensatoires ne rendent plus nécessaires un dispositif de confinement », plaide le directeur, contre l’avis de certains experts.
Le fait que de très importants investissements ont été réalisés pour mettre la centrale au niveau en matière de sécurité parle en faveur de Viktor Chevaldine. Des missions étrangères se succèdent régulièrement à Ignalina pour contrôler et améliorer les procédures et les équipements. Autre puissance nucléaire civile, la Suède, qui signa un accord en ce sens avec la Lituanie redevenue indépendante, est la plus impliquée dans cette surveillance. Située juste de l’autre côté de la mer Baltique, elle n’a aucun intérêt à taire toute défaillance des installations ou négligence du personnel d’Ignalina. Or les experts suédois n’ont pas, à ce jour, relevé d’incidents ni de comportements susceptibles d’éveiller le doute ou l’inquiétude. Du moins n’en ont-ils pas fait part publiquement.
Le néophyte qui visite les lieux ne remarque rien de particulier dans ce domaine, si ce n’est l’aspect vieillot de l’ensemble, en dépit des couches de peinture. Certes, l’approche de la centrale par la route ne donne lieu à aucun contrôle avant d’arriver aux portes mêmes des principaux bâtiments du site. Mais une fois à l’intérieur, les consignes de sécurité semblent, pour autant qu’on puisse en juger, draconiennes et respectées. Une grande partie de la signalisation reste en alphabet cyrillique, puisque 12 % seulement du personnel – trois mille personnes fin 2008 – parle lituanien. Travailler à Ignalina rapporte plutôt bien. Le salaire moyen y est deux fois supérieur à celui pratiqué en Lituanie. Plus on travaille près du cœur des réacteurs, mieux on est payé – à l’exception de la direction. Une façon de motiver les salariés et de maintenir leur vigilance en éveil. Il n’est pas rare, toutefois, que des employés soient licenciés sur-le-champ pour être venus travailler en état d’ébriété.
Dans son bureau tapissé de boiseries marquetées, le patron de la centrale regrette que le gouvernement lituanien et la Commission européenne de Bruxelles aient décidé de la fermeture d’Ignalina « en se fondant sur des critères politiques et non techniques ». « Les politiciens ne comprennent pas toujours tout. Chaque centrale devrait être analysée séparément, en fonction de ses propriétés, de ses besoins en sécurité et de la qualification du personnel », estime-t-il, tout en s’empressant d’ajouter qu’il respecterait la volonté des décideurs politiques. En attendant, il s’inquiète des conséquences sociales du démantèlement prévu.
Peuplée de quelque trente mille personnes, la ville de Visaginas n’existait pas il y a moins de quarante ans. Il n’y avait là que pins et bouleaux. Lorsque Moscou jeta son dévolu sur Ignalina, il fallut bâtir une cité-dortoir pour le personnel de la centrale, qui compta jusqu’à près de cinq mille huit cents salariés. Les travaux de construction débutèrent donc en 1975, selon des plans dessinés par des ingénieurs venus de Leningrad. Deux ans plus tard, une tour de cinquante-cinq appartements se dressait sur la rue de l’Espoir. Aujourd’hui, on en compte environ deux cent cinquante, réparties le long d’une quinzaine de longues rues. Dès le départ, l’idée était de créer là une ville à part entière, avec son hôpital, ses crèches et ses écoles, sa maison de la culture, ses commerces, etc. Comme le voulait l’époque, on baptisa cette nouvelle localité idéale du nom de famille d’un ancien premier secrétaire du comité central du Parti communiste, Sniechkus. En une décennie, elle devint la treizième ville la plus peuplée de la république soviétique de Lituanie.
Ayant retrouvé, en 1992, son nom de Visaginas – celui d’un village jadis situé à cet endroit –, la commune vit dans l’expectative, depuis qu’elle a appris la nouvelle de la fermeture progressive de la centrale, de loin le principal employeur de la région, le plus généreux aussi. Ce fut un choc. Car la population vit littéralement au rythme d’Ignalina. Elle lit des journaux publiés par des équipes de la centrale. Elle observe le niveau de radioactivité dans l’air affiché en permanence, en cristaux liquides, sur un grand panneau érigé dans le centre-ville. Elle paie son électricité deux fois moins cher qu’ailleurs dans le pays. Elle peut même déguster, dans le boui-boui ouvert au rez-de-chaussée du centre culturel, des pizzas Atomine et Radiacine, dont les sauces vous arrachent le gosier… À la mairie, on estime qu’en comptant les sous-traitants, environ la moitié de la population travaille pour la centrale. S’ajoute à cela tout le personnel communal et des secteurs de l’enseignement et de la santé. Le démantèlement progressif d’Ignalina a déjà provoqué le départ d’habitants et des milliers d’autres devraient suivre avec, pour retombée, la fermeture de services sociaux, si aucune alternative crédible n’est trouvée en matière d’emploi.
« Ce n’est pas souvent qu’une entreprise en Europe doit mettre la clé sous la porte, alors qu’elle fait des bénéfices », pointe Andzejus Pupinis, le directeur administratif de la jeune municipalité. Pour l’heure, ajoute-t-il, la population a entendu beaucoup de promesses de la part du gouvernement quant à des aides à la reconversion et à la création de nouveaux emplois. Mais elle a vu peu de réalisations, assure-t-il. La situation géographique de la ville n’est guère favorable, isolée qu’elle est dans l’extrême Est du pays, adossée à la frontière avec la Biélorussie au régime politique peu fréquentable. Quel avenir existe-t-il pour ces russophones – la grande majorité de la population locale ne parle toujours pas couramment le lituanien – dans un pays dénucléarisé ? Et qu’adviendra-t-il de la sécurité à l’intérieur de la centrale, si le millier de personnes qui devraient continuer à y travailler après 2009, le temps de son démantèlement complet, se démobilise et prend son travail à la légère ?
Surfant sur les doutes et le mécontentement d’une partie de la population effrayée à l’idée d’avoir des factures d’électricité encore plus lourdes, certains responsables politiques lituaniens ont fait monter les enchères. « Il y a chez eux une volonté d’interprétation très large des accords conclus », constate un observateur étranger bien informé sur le dossier. Dans le protocole d’adhésion signé avec Vilnius, l’Union européenne s’est engagée à verser des montants considérables [2] pour que le démantèlement d’Ignalina se déroule le mieux possible – une opération que le pays balte aurait été bien en peine de financer tout seul. D’autres donateurs sont également impliqués. Mais un lobby pro-nucléaire lituanien, de plus en plus actif, ne désespère pas d’arriver à modifier la donne d’ici fin 2009, la date prévue pour l’extinction du second réacteur.
Il s’appuie sur un constat, le renchérissement permanent des sources énergétiques traditionnelles, et un souhait, un changement d’approche de la part de l’Union européenne sur le dossier nucléaire. « Les Lituaniens espèrent secrètement qu’une autre vision énergétique s’imposera à Bruxelles, tenant compte à la fois de la hausse des prix de l’énergie et d’une crainte grandissante d’une dépendance vis-à-vis du gaz russe », argumente notre observateur étranger, qui souhaite conserver l’anonymat. Des interruptions momentanées des livraisons de gaz russe exporté vers la Biélorussie, l’Ukraine, la Pologne, l’Allemagne et la Lituanie ont donné du grain à moudre à ce lobby nucléaire. De même, la construction en Finlande d’un nouveau réacteur – de technologie franco-allemande, qui sera d’une capacité de mille six cents MW et battra ainsi le record détenu par Ignalina – est interprétée par certains à Vilnius comme un signe positif dans le sens d’un regain de l’atome.
C’est dans ce contexte que la Lituanie décida, en 2006, avec l’Estonie et la Lettonie, de construire une nouvelle centrale sur le site même d’Ignalina, pour prendre le relais de l’ancienne. La Pologne s’est ensuite jointe au trio, à l’invitation de Vilnius qui l’imposa à ses partenaires. L’entente est loin d’être parfaite entre les quatre États quant aux leurs parts et responsabilités respectives dans le financement, l’exploitation et la production de la future centrale. L’investissement en jeu est considérable puisqu’il est estimé jusqu’à quatre milliards d’euros. Les industriels du nucléaire, dont le français Areva, tentent d’ores et déjà de se placer. La récente crise économique aura-t-elle un impact sur le projet ? Sans aucun doute. Et donc sur le calendrier prévu. Envisagée initialement pour 2015, l’exploitation commerciale de cette entité est désormais annoncée pour 2017, voire 2020, selon les sources.
Encore faut-il que le projet soit mené à terme, ce qui reste incertain, et pas seulement à cause de complications budgétaires. Depuis quelques temps, le front balte menace de craqueler. « Nous avons perdu beaucoup trop de temps » dans cette histoire, décocha le premier ministre estonien, Andrus Ansip, en novembre 2008. Que faire ? Envisager la construction d’une centrale nucléaire estonienne ! L’idée circulait déjà depuis un certain temps dans ce pays, tout comme celle de rallier un nouveau projet nucléaire en Finlande, jugée plus fiable que les autres Baltes. Peut-être ne faut-il toutefois voir là que des coups de bluff en vue de renforcer la position estonienne dans les négociations à quatre et d’accélérer la manœuvre.
Peut-on en dire autant d’une annonce remontant à avril 2008 ? Le Kremlin fit savoir qu’il était temps de doter l’enclave russe de Kaliningrad de deux réacteurs nucléaires. Cet oblast connaîtra, lui aussi, une pénurie d’énergie avec la fermeture d’Ignalina. Plus courts, les délais affichés Moscou pour la construction d’une centrale à Kaliningrad lui donneraient un avantage sur sa potentielle rivale balte. De plus, la capacité de production de ces réacteurs serait bien trop importante pour les seuls besoins du million de personnes résidant dans l’ancienne Königsberg et les alentours. L’excédent d’électricité constituerait donc une source d’énergie idéale pour tout pays voisin qui souhaiterait en importer. Cette logique provoqua immédiatement des haussements de sourcil à Vilnius. Pour le politologue Ceslovas Laurinavicius, « la région n’a pas besoin de deux centrales ». La Russie, selon lui, cherche à torpiller le projet balte, antérieur dans le temps. A moins que son annonce ne soit qu’un coup d’intox pour destiné à ébranler Ignalina bis.
Mais en attendant que le premier KWh sorte d’une nouvelle centrale, il faudra bien s’approvisionner en énergie quelque part. Les Baltes sont pris de cours, ayant tardé à prendre le train des énergies renouvelables. La Lituanie plaide en faveur d’une prolongation du réacteur encore valide d’Ignalina pour maintenir sa stabilité énergétique. Au moins jusqu’à 2012, selon Aleksandras Abisala, le lobbyiste nommé par Vilnius pour tenter de convaincre la Commission européenne. Viktor Chevaldine fait remarquer qu’une dizaine d’autres réacteurs de type RBMK continuent à tourner en Russie « sans que personne ne pose de questions », alors même qu’ils ne font pas l’objet d’un contrôle aussi sévère que ceux d’Ignalina. Dans l’espoir de donner plus de poids à ses revendications, le gouvernement lituanien organisa un référendum le 12 octobre 2008. Approuvez-vous le maintien en activité d’Ignalina au-delà de date prévue par l’accord conclu avec l’Union européenne ? A cette question, l’immense majorité des Lituaniens qui se déplacèrent aux urnes ce jour-là répondirent « oui », sans surprise. Mais le taux de participation prévu par la loi pour reconnaître la validité d’une telle consultation (50 %) ne fut pas atteint, à deux points près. Toujours actif dans les coulisses bien qu’en retraite officielle, l’ancien président et ancien premier ministre Algirdas Brazauskas dit « ne pas croire à tout ce jeu pour la galerie ». Recevant dans le petit bureau qu’il occupe dans une aile du palais présidentiel, à Vilnius, cet homme massif au regard madré pense que « les jeux sont faits ».
La Lituanie se prépare donc à importer davantage de gaz en provenance de Russie, pour faire tourner les centrales thermiques qu’elle rénove pour compenser l’abandon – au moins temporaire – du nucléaire à partir de 2010. Elle table aussi sur la connexion de son réseau électrique à celui de l’Europe occidentale via la Pologne. Un accord finit par être signé dans ce sens avec Varsovie pour réduire la dépendance énergétique des pays baltes vis-à-vis de la Russie. Un premier pas dans cette direction fut franchi en janvier 2007, avec la mise en fonction d’un câble sous-marin reliant l’Estonie et la Finlande. Son doublement par un second câble est prévu d’ici 2013. Un autre devrait relier, peu après, la Lettonie ou la Lituanie au marché électrique suédois, les deux pays baltes se disputant la connexion directe.
Mais la Russie n’a guère de soucis à se faire. Elle tient solidement les manettes énergétiques dans la région. Le groupe étatique Gazprom possède 37 % de la compagnie estonienne Eesti Gas, 34 % de la lettone Latvijas Gaze et autant de la lituanienne Lietuvos Dujos. De plus, un partenaire privilégié de Gazprom, l’allemand E.ON Ruhrgas International, détient également des parts importantes dans ces trois entreprises (respectivement 33,5 %, 47 % et 39 %). Gazprom et E.ON Ruhrgas sont par ailleurs associées dans un projet de gazoduc au fond de la mer Baltique, Nord Stream, qui a fait couler beaucoup d’encre dans les républiques baltes et en Pologne. Celles-ci ont dénoncé cette réalisation russo-allemande pour des raisons économiques et politiques.
Sur le fond, elles auraient de loin préféré que le tuyau, par lequel doit transiter le gaz de Sibérie vers l’Allemagne à partir de 2011, passe par leurs territoires respectifs et non au large, dans les eaux internationales de la Baltique. C’eut été un moyen pour elles de prélever un droit de passage auprès des exploitants. Et de pouvoir, en cas de conflit grave avec Moscou, se servir du gazoduc comme d’un moyen de pression avec la possibilité, en dernier recours, de fermer leur tour le robinet, comme la Russie le fit déjà à leur encontre. De ce point de vue-là, on peut comprendre pourquoi Gazprom privilégia la voie maritime… Sur la forme, Baltes et Polonais, qui affirment ne pas avoir été consultés par Moscou et Berlin, dénoncèrent la méthode employée dans cette décision stratégique, « dénuée de tout transparence », nous dira Toomas Hendrik Ilves. Un rictus aux lèvres, on nota de ce côté-ci de l’Europe l’élégance avec laquelle l’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, sitôt vaincu dans les urnes à l’automne 2005, accepta l’offre lucrative de Gazprom de présider le conseil de surveillance de Nord Stream, projet dont il avait été le parrain attentionné avec Vladimir Poutine, son ami qu’il qualifia un jour de « démocrate pur jus ». Il n’en fallut pas plus pour ressusciter dans l’esprit des plus offensés le spectre du pacte Molotov-Ribbentrop, par lequel l’Union soviétique et l’Allemagne nazie se partagèrent secrètement l’Est de l’Europe d’août 1939.
Pour Berlin, ce gazoduc n’est pas réservé à l’Allemagne, il doit bénéficier à d’autres pays. Les Pays-Bas, notamment, s’y sont joints [3]. Le projet industriel fut également adoubé par la Commission de Bruxelles, qui y vit un moyen supplémentaire appréciable d’assurer l’approvisionnement de l’Europe. La réalisation sur le terrain s’est toutefois avérée plus laborieuse que prévu par ses initiateurs. Les pays dont les eaux territoriales sont les plus proches du tracé retenu pour Nord Stream – l’Estonie, la Finlande, la Suède et le Danemark – firent savoir qu’ils seraient très exigeants quant au respect de l’environnement. La Baltique, l’une des mers les plus polluées de la planète, est plus fragile que d’autres : elle est semi-fermée, peu profonde (cinquante-deux mètres en moyenne, contre mille cinq cents en Méditerranée) et alimentée par de faibles courants salins arrivant par le détroit séparant le Danemark et la Suède, L’Estonie a d’ores et déjà refusé d’accorder un permis d’exploration des fonds marins au consortium Nord Stream AG, renvoyant la balle dans le camp finlandais. Helsinki, qui aurait préféré voir le gazoduc passer en zone estonienne, publiera en 2009 une étude décisive sur l’impact environnemental du projet.
En outre, d’importantes quantités de munitions datant de la Seconde guerre mondiale reposent au fond de la mer [4]. Des mines aussi, qui ont été enfouies par dizaines de milliers dans le sous-sol du golfe de Finlande, après la guerre. Ces impedimenta risquent de gêner les travaux, et notamment l’ancrage du navire qui posera les tuyaux du gazoduc. Enfin, les vieux réflexes de la guerre froide n’ayant pas complètement disparu, certains virent dans le projet de plate-forme de maintenance prévu au large de l’île suédoise de Gotland un avant-poste idéal pour les espions russes… Nord Stream AG fit une croix sur la plate-forme et modifia certains points du tracé, long de mille deux cents kilomètres.
Bref, le projet, dont la fin fut annoncée initialement pour 2010, prit du retard. Les estimations quant à son coût total augmente, rendant la rentabilité plus incertaine. Moscou s’impatiente. En novembre 2008, Vladimir Poutine fit savoir que, si ça continuait de la sorte, son pays pourrait remiser Nord Stream aux oubliettes. « L’Europe doit décider si elle a besoin ou non de ce pipeline. Sinon, nous construirons à la place des usines pour liquéfier le gaz que nous exporterons sous cette forme dans le monde entier, Europe comprise », avertit le premier ministre, lors d’une visite de son homologue finlandais, Matti Vanhanen. En gros, débrouillez-vous pour accélérer la manœuvre en Baltique ou bien vous aurez une part moins alléchante de notre pactole gazier. L’Europe peut-elle se passer de ces ressources-là ? Mais la même question vaut pour la Russie. A-t-elle les moyens de tourner le dos à l’Europe ? Il semble, selon l’avis d’experts, que la sortie de Vladimir Poutine vise aussi à faire gagner du temps à la Russie, en jetant la pierre à autrui pour détourner l’attention loin de ses problèmes. Il est de notoriété publique que le pays n’a pas assez investi dans ses infrastructures et qu’il risque de peiner à honorer ses engagements de livraison en gaz.
Dans cette problématique qui les dépasse, les États baltes n’ont qu’une marge de manœuvre restreinte. Et des intérêts divergents. Depuis le début, la Lettonie joue un jeu alambiqué consistant à dénoncer, avec les autres, la vilaine complicité russo-allemande, tout en faisant du pied au consortium pour obtenir le stockage d’une partie du gaz dans ses immenses réservoirs naturels, d’une capacité de plus de 2,3 milliards de mètres cubes. Un tel raccordement à Nord Stream est possible, fait-on valoir à Riga, moyennant d’importants investissements que la Lettonie ne saurait engager seule. Depuis la fin des années 1960, c’est une vieille histoire, du gaz russe est accumulé l’été dans le sous-sol de la commune d’Incukalns, non loin de la capitale, pour être redistribué l’hiver vers les villes baltes et Saint-Pétersbourg, essentiellement à des fins de chauffage.
En Lettonie, l’odeur du gaz se sent ailleurs qu’à Incukalns. La filiale lettone d’Itera, un acteur important du gaz en Russie, acquit au printemps 2008 près de 40 % des actions d’un nouveau club de hockey sur glace, le Dinamo Riga, qui a repris un nom bien connu durant la période soviétique. Depuis, il a commencé à jouer dans la Ligue de hockey continentale, qui compte les meilleurs clubs de Russie plus quelques-uns d’anciennes républiques soviétiques. Qui trouve-t-on parmi les autres principaux actionnaires du Dinamo Riga, au côté d’Itera Latvija ? Aigars Kalvitis qui, jusqu’en novembre 2007, dirigeait le gouvernement letton. Interrogé par le quotidien Diena sur cette aventure extra-politique, l’intéressé, qui promit d’investir 200 000 lats (285000 euros) dans le club, répondit qu’il ne fallait pas y voir de « conflit d’intérêts ». D’avancer comme certains que le Parti populaire, qu’il dirigeait encore, est « le parti du gaz » est « dénué de tout sens ». Le même Diena rappela les liens étroits qui unissent le directeur d’Itera Latvija à Andris Skele, l’oligarque qui dirige en coulisse le Parti populaire, depuis la privatisation en 1996 – sous le gouvernement Skele – de la compagnie Latvijas Gaze, qui distribue le gaz dans le pays.
Copyright 2009-Jacob/Lignes de repères
Présentation par l’éditeur
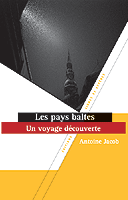
Les pays baltes. Un voyage découverte, par Antoine Jacob, éditions Lignes de repères.
Aux confins de l’Europe et de la Russie, les pays baltes ont à la fois un destin commun et de profondes spécificités.
Un destin commun illustré par leur entrée simultanée dans l’Union européenne en 2004, à l’issue d’une longue parenthèse soviétique. Disposant cependant de leur identité propre, Estonie, Lettonie et Lituanie demeurent peu connus, en dépit de leur dynamisme économique –mis à mal par la crise - et de leur attrait touristique croissant.
C’est à un voyage découverte qu’invite cet ouvrage, mêlant récits, rencontres et analyses ; destiné tant au touriste visitant ces pays qu’au lecteur curieux, l’ouvrage aborde tous les aspects, de l’histoire à la culture, en passant par l’actualité de ces pays, touchés de plein fouet par la crise économique.
Il est composé de 19 chapitres, dont notamment :
. Obscures décennies ;
. L’occupation au quotidien ;
. La consommation, nouvelle religion ;
. Les réformes à bras le corps ;
. Etre russophone à Riga ;
. Intégrer les minorités ;
. Nouveaux riches, nouveaux pauvres ;
. Riga, art nouveau ;
. Surmonter les crises.
Le site des éditions Lignes de repères Voir
Pour ne rien rater de nos nouvelles publications, abonnez-vous à la Lettre du Diploweb !
[1] Les réacteurs de Tchernobyl et d’Ignalina sont de type RBMK (reactor bolshoy moshchnosty kanalny), fonctionnant à l’eau ordinaire bouillante, modérés par du graphite et utilisant un combustible au dioxyde d’uranium faiblement enrichi.
[2] Une première tranche de 285 millions d’euros fut prévue pour la période 2004-2006. Une seconde tranche prévoit une enveloppe supplémentaire de 837 millions d’euros pour la période 2007-2013.
[3] Gazprom détient 51 % de Nord Stream AG, les entreprises privées allemandes BASF/Wintershall AG et E.ON Ruhrgas 20 % chacune, et la néerlandaise Nederlandse Gasunie NV 9 %.
[4] Les Alliés déversèrent, en Baltique et en mer du Nord, quelque trois cent mille tonnes de munitions que l’Allemagne n’avait pas utilisées. Parmi elles, du gaz moutarde, un agent s’attaquant au système nerveux appelé tabun, du gaz lacrymogène et un suffocant, le phosgène. Le 30 mai 2008, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe demanda au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à l’OTAN de déclassifier sans tarder les informations relatives à la localisation des sites de la Baltique.
Direction

Directeur, P. Verluise
Conseil scientifique
Mentoring et coaching géopolitique
Présenter le Diploweb.com
Charte du site
Auteurs
Proposer un article
Retrouvez la chaîne Diploweb sur :











